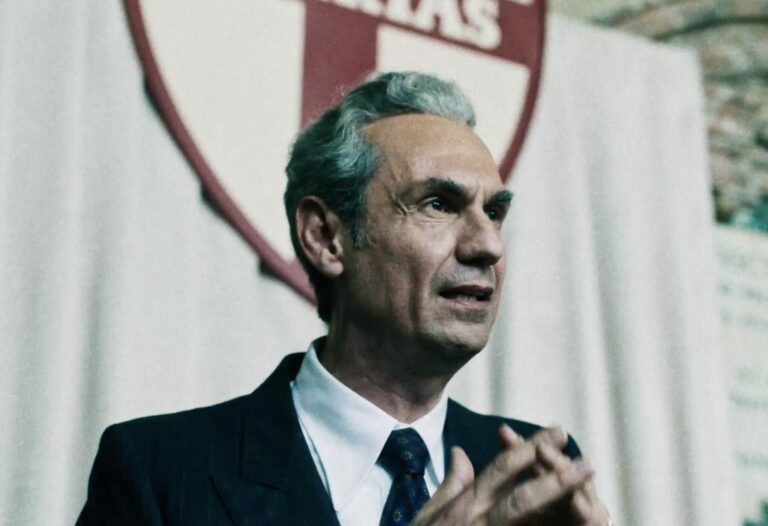Esterno notte, film de type fleuve et en six actes, écrit à plusieurs mains (Stefano Bises, Ludovica Rampoldi et Davide Serino) et en réalité destiné à la télévision italienne, joue de son titre comme le récit jouera des points de vue – à la manière du procédé Rashômon, inspiré du film au titre éponyme de Kurosawa – pour notre plus grand plaisir, notre liberté et au service du cinéma. Remontant à mars 1976 pour en arriver deux ans plus tard (période qui appartient aux années de plomb qui s’étalent davantage), partant d’une prolepse initiale, Marco Bellochio, revenant à ses anciennes amours (cf. son Buongiorno notte en 2003), vient nous rappeler ce qu’ont été les Brigades rouges, ce petit groupe armé étudiant qui a enlevé le premier ministre de l’époque et pourtant pas le pire, Aldo Moro, dans sa lutte révolutionnaire anticapitaliste, et alors même qu’il était sur le point de faire rallier le parti communiste à son parti démocratique chrétien, envers et contre ses camarades politiques, ses opposants comme aussi les États-Unis, peureux. Les 300 minutes de cette fresque politique nous embarquent ainsi au centre du pouvoir – politique, religieux sous Paul VI, interprété par ce cher Tony Servillo, et humain – dans ce XXe siècle où tout est remis en doute ou en cause, et où les guerres de pouvoir ont déjà (re)commencé.
Le film allie un souci d’objectivité analytique lié à la représentation des différents points de vue des personnages vis-à-vis de la situation dramatique, et la possibilité d’une identification parce que le cinéaste ne dénie pas à ses personnages leurs caractéristiques affectives,
Marco Bellochio semble n’avoir plus rien à prouver dans sa manière de cinéma que d’aucuns caractériseront de classique, et est-ce grave ? Grave, le temps du film l’est comme la réflexion vers laquelle il nous porte quand la qualité du cinéaste consiste, d’un côté, en sa maîtrise de toutes les techniques cinématographiques au service d’une pensée, d’une idée, d’une vision du monde soit d’un art, ce alors même que nombre de séquences du récit sont un bonheur poétique autant que des surprises filmiques. Bellochio partage avec nous cet art du croisement : par le biais des montages (parallèle ou alterné), à se faire se croiser des images tournées ou d’archives – pour parler de l’enlèvement qui a chahuté tout un pays – ou à faire s’enchaîner celles de situations souvent remplacées par la représentation qu’en ont les personnages – à travers leur peur, leur fantasme ou leur projection. Le ministre de l’Intérieur, proche ami et frère moral d’Aldo Moro, Francesco Cossiga (Frausto Russo Alesi), est un représentant de ce procédé et y excelle. Bellochio pose ainsi un état de l’art politique comme cinématographique, ce qui lui est facilité par les six épisodes enchaînés qui montrent deux intérêts du cinéaste au moins ; un souci d’objectivité analytique lié à la représentation des différents points de vue des personnages vis-à-vis de la situation dramatique, et la possibilité d’une identification parce que Belllochio ne dénie pas à ses personnages leurs caractéristiques affectives, ce qui autorise au spectateur d’être familier autant avec les « coupables », les Brigades criminelles rouges, que la victime ou les victimes collatérales. Là est bien le pouvoir du film qui allie le public et le privé, soit le politique et l’intime, du point de vue de la vision donc de la réception. Ce seront moult détails inscrits dans l’image, à travers leur fugace présence, leur force fantôme ou leur côté appuyé qui seront là pour rappeler que derrière toute fonction, ici politique, se cache un homme, une femme, à qui on ne peut soustraire ses qualités (ou ses défauts) humaines. Cossiga croit qu’il a des taches sur les mains (a-t-il les mains sales ?), Paul VI voit Moro porter sa croix au milieu d’une assemblée urbaine politique, quand Adriana Faranda, héroïne rouge, voit les corps des défunts divers flotter le long d’une rivière.
Là est bien le pouvoir du film qui allie le public et le privé, soit le politique et l’intime, du point de vue de la vision donc de la réception.
C’est donc bien le principe de la durée et de la série qui permettent au spectateur d’entrer dans la vie de ces personnages fictifs, rendus libres pour les besoins d’adaptation dramatique (comme l’exprime le générique), et de nous faire partager la vie de ces héros de quelques mois, partagés entre des fonctions publiques que tout un peuple surveille, et des rôles plus secrets qui échappent à tout un chacun. Les deux figures féminines sont en ce sens très révélatrices : d’un côté, l’épouse d’Aldo Moro, Eleonora (la charmante Margherita Buy) est prise entre la notoriété de son statut et l’angoisse qui anime tout simplement une femme qui ne sait soudainement plus rien d’un mari dont elle connaissait pourtant la liste de ses médicaments, ses tocs (penser à éteindre le gaz la nuit) ou l’amour porté à leur petit-fils. Entre le bien et le mal faire, sa marge, relativement limitée, est pourtant accrue par le jeu d’actrice qui la prend entre complexité d’un geste qui peut faire tout basculer, et la spontanéité propre à toute personne en proie à l’inquiétude quotidienne et qui doit pourtant garder tête haute. En parallèle, Adriana Faranda, embarquée dans les Brigades rouges par son amoureux, a abandonné sa petite pour ses idées utopiques, préférant déposer lettres anonymisées ou fabriquer les costumes de l’attentat, que rester dans sa petite vie prolétarienne sans espoir. Pourtant, lorsqu’elle comprend que le groupe ne se bat pas uniquement pour de belles idées mais parce qu’il a pris le pouvoir (celui de désobéir et d’agir contre un système à qui il parvient à voler le pouvoir), on lui voit un visage pris entre le rire de la joie et les larmes de la désillusion, elle dont la photo sera présente à l’avant de tous les véhicules de police à sa recherche. C’est que Bellochio manie à bon rythme le suspens – chaque ministre comme le pape signifiera physiquement son malaise, en vomissant, tremblant, se déformant ou s’affaiblissant –, tout en le désamorçant en prenant des libertés à travers des plans, qui, en étant orientés vers le ciel en contre-plongée (depuis le siège du Parti, drapeaux levés), ou à travers des séquences purement psychiques, à la manière de rêves (éveillés) ou d’absences (re.figurées) offrent des respirations. La tentative de reconstitution (faussement) documentaire frôle la fantaisie et fait naître une poésie… de l’image.
La tentative de reconstitution (faussement) documentaire frôle la fantaisie et fait naître une poésie… de l’image.
Esterno notte, en jouant ainsi sur les espaces (du dedans, du dehors, public ou de l’intime) comme sur les temporalités (avant, après via les flashbacks ou les prolepses, les images d’archives ou de création) s’avère ainsi une réflexion sur qu’est le cinéma, image-temps, image-mouvement, ces deux tomes de Deleuze qui fonctionnent non comme « seulement une suite. C’est le complément indispensable. » de la même manière que ces six épisodes, devenus, par les choix esthétiques aussi fluides qu’ils sont créateurs d’émotions, une réflexion sur l’histoire des genres et du genre au sein du cinéma italien comme européen. Fonctionnant en intertextualité avec sa propre œuvre et un précédent film traitant du même évènement tragique, mais aussi avec les genres (opéra, littérature et théâtre) puisqu’il est question d’écriture comme de mise en scène (notamment lors d’une scène de théâtre reconstituant l’enlèvement et extrêmement réussie grâce aux enchaînements de plans), précisément de « style » (quel mot choisir), le film fait aussi clin d’œil au dernier film de fiction d’un compatriote, Nanni Moretti, (Tre Piani, 2021) dans lequel Margherita Buy jouait également une veuve de personnage public (un magistrat), comme il rappelle le premier documentaire de Jean-Gabriel Périot, Une jeunesse allemande (2015), mettant en scène les jeunes héros de la Fraction Armée rouge. On pourrait citer encore bien d’autres réflexions mises en œuvre durant ces 300 minutes – qui n’omettent pas de parler (psycho)thérapie singulière ou collective, à travers la présence d’un psychiatre à l’écoute, d’un prêtre ou d’une nonne hors norme, de déontologie par et pour la religion, le politique et leurs conflits de loyauté, ou de sacré puisque deux fêtes de Pâques traversent les deux ans concernés – et l’on s’en tiendra aux dernières paroles d’un confiné (au passage vouloir reparler de cet enfermement après deux ans de confinement, il fallait le faire) pour qui l’on peut renoncer à tout, sauf à la vie. C’est ce que fait Marco Bellochio, dans son cinéma, et dans cette générosité qu’il a de partager des images de vie, encore marquantes et toujours marquées dans les livres d’Histoire comme dans l’histoire des mentalités. Bravo.
RÉALISATEUR : Marco Bellochio NATIONALITÉ : Italien AVEC : Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Daniela Marra, Gabriel Montesi, Fabrizio Contri, Paolo Pierobon GENRE : drame politique et psychologique DURÉE : 300 minutes (6 épisodes) SORTIE LE 15 et 16 mars sur Arte