Duel est sorti dans les salles en France le 21 mars 1973. C’était la toute première sortie d’un film de Spielberg au cinéma. Fêter en 2023 les cinquante ans de carrière de Steven Spielberg se justifie donc parfaitement. Celui qui est devenu le cinéaste le plus célèbre de la planète méritait bien un hommage de notre rédaction. Ce qui est frappant chez Spielberg, c’est la diversité impressionnante des genres qu’il a abordés : thriller (Duel, Les Dents de la mer), road-movie (Sugarland Express), science-fiction (Rencontres du 3ème type, E.T., A.I., Minority report, La Guerre des mondes, Ready Player One), comédie (1941, Le Terminal), drame historique (La Couleur pourpre, L’Empire du soleil, La Liste de Schindler, Munich, Pentagon Papers), aventure (Les Aventuriers de l’arche perdue, Jurassic Park), comédie romantique (Always), guerre (Il faut sauver le soldat Ryan, Cheval de guerre), comédie dramatique (Arrête-moi si tu peux). animation (les Aventures de Tintin), espionnage (Le Pont des espions), comédie musicale (West Side Story), autofiction (The Fabelmans). Seuls le western et le péplum lui ont échappé pour l’instant.
Il ne s’agissait pas ici pour autant de se montrer exhaustif. C’est une sélection subjective, volontairement partielle et partiale des films de Spielberg préférés par la rédaction : sur un total considérable de 36 films, seules vingt oeuvres (+ un film bonus) ont été retenues, pas forcément les plus réputées ni les plus connues. Vous ne trouverez pas dans ce dossier les Indiana Jones qui auraient mérité un article entier à part, d’autant plus qu’ils appartiennent autant à George Lucas qu’à Steven Spielberg. Nous avons également omis deux écueils assez récurrents chez Spielberg : les films pour enfants, trop sucrés et mièvres (Hook, Les Aventures de Tintin, Le Bon Gros Géant), les drames historiques longs, emphatiques et souvent soporifiques (Amistad, Il faut sauver le soldat Ryan, Lincoln).
Steven Spielberg est sans doute le cinéaste le plus schizophrène de l’histoire du cinéma A sept reprises, il a sorti dans la même année deux films complètement dissemblables, l’un destiné au public, l’autre, plus personnel, pour lui, le paradoxe étant que le plus réussi des deux n’est pas toujours le plus intime : 1989 (Indiana Jones et la dernière croisade et Always), 1993 (Jurassic Park et La Liste de Schindler), 1997 (Le Monde perdu et Amistad), 2002 (Minority Report et Arrête-moi si tu peux), 2005 (La Guerre des Mondes et Munich), 2011 (Les Aventures de Tintin et Cheval de guerre) et 2018 (Pentagon Papers et Ready Player One). Et nous n’incluons même pas dans la liste en 1982 E.T. et Poltergeist, signé par Tobe Hooper, mais conçu, scénarisé et produit par Spielberg. Comme si le fait de faire des blockbusters permettait financièrement de monter les projets les plus risqués et personnels ou inversement que le fait de concevoir des films à Oscars, destinés à recueillir les suffrages des membres de l’Académie, autorisait à se lâcher dans des films joyeusement divertissants et récréatifs. Docteur Steven et Mister Spielberg. Lors des années 1993-1994, c’est sans doute le seul cinéaste à avoir atteint les sommets du box-office (Jurassic Park), tout en ayant obtenu la reconnaissance des critiques et de l’Académie des Oscars (La Liste de Schindler), avec deux films différents. Quelques années plus tard, en 1997, James Cameron réussira la même prouesse avec un film unique, Titanic.
Spielberg s’est longtemps vu comme un imposteur, celui du groupe du Nouvel Hollywood qui n’avait pas fait d’études dans une prestigieuse université de cinéma (alors que Scorsese, De Palma, Lucas, Coppola ont tous étudié à NYU ou USC, lui a dû se contenter d’une université plus modeste à Long Beach dont il a d’ailleurs à peine suivi les cours, préférant déjà réaliser des séries et téléfilms pour le studio Universal). Ce sentiment d’exclusion l’a longtemps poursuivi et continue d’ailleurs à le hanter, ce qui l’a mené à enchaîner les oeuvres et la plupart du temps les réussites, à continuellement se remettre en question et à demander toujours l’amour du public, pour tenter de cicatriser cette fêlure originelle. Longtemps la critique élitiste l’a ignoré, le prenant pour un vulgaire faiseur de blockbusters, ne se doutant guère que derrière ses films se cachaient de véritables classiques du cinéma. La carrière de Steven Spielberg ressemble à un parcours bipolaire avec des hauts qui peuvent se prolonger (de Duel à Indiana Jones et la dernière croisade, de A.I. à Munich) et des bas récurrents (de Always à Hook, de Indiana Jones et le Royaume de Cristal à Lincoln), ce qui a longtemps fait qualifier son oeuvre de fondamentalement inégale. Certes, sur 36 films, on peut compter environ quatre ou cinq films ratés et à peu près autant de films moyens ou anodins, en fait guère plus que ceux de ses illustres collègues. Son oeuvre montre sur cinquante ans une métamorphose des plus passionnantes : de roi du film de genre et de divertissement (Duel, Les Dents de la mer, Rencontres du troisième type, E.T.), il est progressivement passé à un statut de cinéaste politique, peut-être l’un des plus engagés à Hollywood (Munich, Le Pont des espions, Pentagon Papers, West Side Story). Et si, contrairement à ce que l’opinion critique sous-entend souvent, de tous les metteurs en scène importants issus du Nouvel Hollywood, Spielberg était finalement le plus grand?
David Speranski
Duel : à la route, à la mort !

Tourné avec un petit budget (moins de 400 000 $) au Nord-Est de Los Angeles, au départ pour la télévision, ce qui explique son format 4/3, ce deuxième long métrage du tout jeune Steven Spielberg est réellement un coup de maître, d’une maitrise étonnante, qui lança la carrière de l’un des Wonder Boy du cinéma américain. Lors de sa première diffusion en novembre 1971 sur A.B.C., le film rencontre un énorme succès, ce qui permet à Universal de le sortir en salles à l’étranger, surtout en Europe dans une version rallongée de 16 min (Spielberg tourna pour l’occasion des scènes supplémentaires). En 1973, le film remporte même le Grand Prix du premier Festival d’Avoriaz.
Duel met en scène un représentant de commerce, David Mann, au volant de sa voiture qui se retrouve bloqué par un camion roulant lentement et dégageant une épaisse fumée. Il le dépasse, le camion le dépasse à son tour. C’est le début alors d’une course-poursuite effrénée dont l’issue paraît bien incertaine. L’un des points forts de cette œuvre de jeunesse, adaptée d’une nouvelle de Richard Matheson (elle-même inspirée d’une aventure arrivée à l’auteur), crédité comme scénariste, reste sans nul doute la mise en scène de Spielberg (qui se montre déjà très à l’aise dans les scènes d’action pure, l’un des traits structurants de sa future filmographie).
Avec précision, un sens du cadre et du découpage, le cinéaste réussit à faire monter la tension et l’angoisse dans ce qui s’apparente à une version sur route du western (impression renforcée, en plus du titre très éclairant, par les paysages désertiques de la Californie). Le recours à des caméras fixées sur une voiture pour les scènes filmées embarquées permet notamment aux spectateurs d’être au plus près du suspens. Mais le pari le plus judicieux et le plus réussi est d’avoir choisi, en face d’un Américain ordinaire pris dans la tourmente et auquel le spectateur peut s’identifier (grand classique dans le cinéma américain, un peu à l’image de Roger Thornhill dans La Mort aux trousses), interprété par Dennis Weaver (que Spielberg avait repéré dans La Soif du mal d’Orson Welles), un chauffeur de camion anonyme dont on ne découvrira jamais le visage durant toute la confrontation. Mais dont on verra néanmoins quelques attributs, comme les santiags dans la scène du restaurant station-service, seule pause dans le récit. Son camion, filmé dans les moindres détails (intérieurs comme extérieurs), donne des indications sur son conducteur.
Au niveau de l’écriture, Spielberg et Matheson se sont concentrés sur l’essentiel et d’ailleurs ne se sont embarrassés ni de psychologie, ni d’explications : ainsi, nous ne connaîtrons pas vraiment les motivations du routier (pourquoi en effet, un tel acharnement sur un automobiliste innocent ?), l’objectif étant de mettre en scène cette lutte à mort entre un dénommé « Mann » (l’homme, en allemand) et un camion dont le chauffeur ne semble pas être humain (« la machine »). L’ensemble prend alors la forme certes d’un divertissement mais placé sous le signe de l’épure, de l’abstraction même, et d’un certain minimalisme (à la fois dans la forme et dans le fond) terriblement efficace : ce qui, somme toute, restera relativement rare dans la suite de la carrière de Spielberg capable du meilleur (Jaws, ou plus récemment The Fabelmans) comme du pire (Always, Hook ou une adaptation dispensable des aventures de Tintin).
La lutte engagée, qui apparaissait au départ comme une sorte de provocation gratuite, devient au fil de l’intrigue un combat vital dans lequel l’instinct de survie de David Mann prend le dessus, décuplant son énergie et lui donnant des forces insoupçonnables. C’est ainsi, qu’une fois victorieux de ce duel sans merci, il manifestera sa joie de manière très expressive, finissant même par contempler longuement le « cadavre » de ferraille du camion dans le ravin. Avant de s’asseoir face au coucher du soleil, une fois l’adrénaline retombée, dans un repos final bien mérité. Le repos du guerrier, du vainqueur.
Il faut bien l’avouer. Après avoir vu ce film, il est bien difficile de rester stoïque sur la route à la vue d’un camion doublant à grande vitesse sa propre voiture.
Xavier Affre
Sugarland Express : la gloire ou la mort

« Du point de vue du plaisir que la maîtrise technique procure au public, ce film est l’un des premiers les plus phénoménaux de toute l’histoire du cinéma « . Pauline Kael, qui s’est montrée parfois très injuste et cruelle envers bien des films, n’a pas tari d’éloges concernant ce premier véritable film de Steven Spielberg. Coincé entre Duel et Les Dents de la mer, Sugarland Express a pourtant légèrement sombré dans l’oubli, probablement à tort. Auparavant, Spielberg a tourné à 18 ans un premier film en super-8, Firelight, qui a eu droit à une seule projection publique et n’est jamais sorti ensuite en salles. Duel était à l’origine un téléfilm qui n’est finalement sorti qu’en Europe et non aux Etats-Unis ou dans le reste du monde. Par conséquent, seul Sugarland Express signe les véritables débuts de Steven Spielberg au cinéma ; c’est même sans doute son long métrage le plus émouvant.
Sugarland Express raconte l’odyssée de deux délinquants, mari et femme, Clovis et Lou Jean Poplin pour récupérer leur fils, confié à une famille d’accueil. Par un mauvais concours de circonstances, sans avoir tué qui que ce soit, Lou et Clovis kidnappent un policier qui va devenir leur otage, puis progressivement leur complice consentant. Sugarland Express appartient au genre du road-movie, particulièrement en vogue depuis la naissance du Nouvel Hollywood (Bonnie et Clyde, Easy Rider), et plus précisément des couples en cavale, remontant à des exemples plus anciens comme J’ai le droit de vivre de Fritz Lang, Les Amants de la Nuit de Nicholas Ray et Gun Crazy de Joseph H. Lewis. Spielberg s’inscrit donc dans un genre connoté, celui où les amants romantiques sont poursuivis sur la route, condamnés par la fatalité car en réalité innocents de tout ce dont on les accuse. La même année d’ailleurs, un autre très grand cinéaste, Terrence Malick, a sorti également un road-movie qui est resté, lui, très célèbre, La Balade Sauvage. Depuis, on peut retrouver des échos de Sugarland Express dans d’autres road-movies américains réalisés dans les années 90, Sailor et Lula de David Lynch, Thelma et Louise de Ridley Scott (le même esprit, rebelle, anticonformiste et innocent existe chez Thelma et Louise) ou encore Un Monde parfait de Clint Eastwood (toute la fin).
En voyant The Fabelmans, on comprend mieux ce qui a pu intéresser Spielberg dans ce fait divers qui s’est réellement passé quelques années plus tôt, en 1969. Alors que le jeune Steven souffrait toujours du divorce de ses parents, il a vu dans cette histoire un couple prêt à tout pour récupérer leur enfant, ce qui ne pouvait que l’émouvoir jusqu’aux larmes. Ce souhait de réunion au-delà des lois et de la justice représentait la situation complètement inverse de ce qu’il avait vécu dans sa propre famille, ce qui explique qu’il lui ait consacré son premier film de cinéma.
Stylistiquement, hormis la maîtrise hors pair des scènes d’action, Sugarland Express ne ressemble pas vraiment au reste de la filmographie du Wonder Boy et évoque ce qu’aurait pu être la carrière de Steven Spielberg s’il était devenu un cinéaste indépendant. Il se caractérise par les caractéristiques suivantes : absence d’effets spéciaux, attention donnée aux acteurs, maîtrise de la progression dramatique et de la mise en scène (un ballet de voitures parfaitement chorégraphié). C’est avec ce film que Spielberg se révèle un exceptionnel directeur d’acteurs et surtout d’actrice : Goldie Hawn y tient son plus beau rôle, de très loin, en femme-enfant immature et profondément touchante. C’est aussi la première affirmation d’un féminisme non revendiqué en tant que tel et pourtant bien réel, que l’on retrouvera de loin en loin, mais régulièrement, chez les personnages féminins de La Couleur pourpre, Dorinda dans Always, Katharine Graham (Pentagon Papers) ou encore Mitzi Fabelman (The Fabelmans).
C’est donc par la mère, souvent le personnage le plus crucial dans la famille des personnages de Spielberg, que naît une émotion qui n’a pourtant rien de mélodramatique (contrairement à un grand nombre de ses films), une émotion sobre, sèche et irrépressible comme une marée montante. La quête de Clovis et Lou Jean est vouée à l’échec ; cependant, le film, pendant 90% de son déroulement, montre la situation sous un jour presque joyeux et enthousiaste, les fugitifs étant portés par une vague de popularité invraisemblable et inexplicable. En cela, Spielberg s’est inspiré du Gouffre aux chimères de Billy Wilder, en décrivant un phénomène médiatique qui s’amplifie progressivement à partir d’un fait divers presque banal. Clovis et Lou Jean deviennent ainsi des vedettes, ce qui les incite à continuer leur quête d’un impossible bonheur. Seul Clovis semble se rendre compte de leur échec programmé lorsqu’il synchronise pour Lou Jean un dessin animé vu via l’écran d’un drive-in et s’interrompt brutalement lorsqu’il voit le coyote tomber d’une falaise dans un ravin. Spielberg situe également son oeuvre sous le patronage humaniste de John Ford en lui empruntant Ben Johnson, le cow-boy du mythique Convoi des Braves, pour le rôle du Capitaine Tanner, policier a priori sympathique et loyal.
La fin du film s’annonce tragique et ne nous déçoit pas. Pourtant l’impression de tristesse est surtout créée par la mise en scène et la musique de John Williams (première collaboration avec Spielberg pour Williams qui a depuis composé la musique de tous les films de Spielberg, hormis La Couleur pourpre et Ready Player One). Car, si on regarde bien le dernier plan, on s’aperçoit à la lecture des informations incrustées que le film se termine bien pour la plupart des protagonistes, dont deux membres de la famille Poplin, montrant l’incurable optimisme de Spielberg à cette époque. Mais l’atmosphère de la fin, renforcée par la musique lancinante, fait que, contrairement à ses autres films, cette happy end demeure inaperçue. Ceci explique sans doute l’échec cuisant du film au box-office, à peine compensé par un Prix du Scénario glané au Festival de Cannes 1974, le seul prix jamais remporté par Steven Spielberg à Cannes. Depuis Sugarland Express pâtit de cet échec commercial, rare chez Spielberg, et est resté dans l’ombre de beaucoup de ses succès. A tort certainement car il s’agit d’un grand film qu’il est urgent et indispensable de redécouvrir.
David Speranski
Les Dents de la mer : le requin du succès !

Après Duel et Sugarland Express, Steven Spielberg sort en 1975 Jaws (traduit en français par Les Dents de la mer), adaptation d’un roman à succès de Peter Benchley publié l’année précédente. Ce dernier a écrit la première mouture du scénario, Carl Gottlieb l’a modifié pendant le tournage qui s’est révélé être long et éprouvant (budget en constante augmentation, faux requins défectueux, menace de grèves sur le plateau, comédiens peu convaincus…).
Le sujet annonce un film à la fois ambitieux et terrifiant : à quelques jours du début de la saison estivale, les habitants de la petite station balnéaire d’Amity sont mis en émoi par la découverte sur le littoral du corps atrocement mutilé d’une jeune vacancière. Pour Martin Brody, le chef de la police, il ne fait aucun doute que la jeune fille a été victime d’un requin. Il décide alors d’interdire l’accès des plages mais se heurte à l’hostilité du maire uniquement intéressé par l’afflux des touristes.
Le film est un tournant à plus d’un titre : dans la carrière de Spielberg – dont ce n’est que le quatrième long métrage – qui est définitivement lancée ; au niveau des recettes et du box-office (les 12 millions de dollars de budget sont remboursés en seulement quelques jours, c’est aussi le premier film à dépasser les 100 millions de dollars de recette aux États-Unis) ; enfin à propos de la stratégie commerciale des studios (le film lance ainsi la mode du blockbuster estival, alimenté par des campagnes de publicité agressives).
Pour autant, il serait injuste de limiter Jaws à ces considérations économiques, aussi importantes soient-elles. Il apporte la preuve que Steven Spielberg est bien un cinéaste talentueux, très habile dans la mise en scène des séquences d’action : celles situées sur les plages mais plus encore celles situées dans l’eau (les attaques du requin) impressionnent par leur réalisme. Le film navigue allègrement entre le thriller et le film d’horreur, réservant quelques moments de pur effroi. À ce titre, la séquence d’ouverture est un modèle du genre : alors qu’une fête a lieu sur la plage un soir, une jeune femme décide d’aller se baigner et finit par se faire attaquer par le squale avant de disparaître totalement sous l’eau. Pouvoir total de la suggestion puisque le spectateur ne voit jamais l’animal en question mais croit immédiatement à ce qu’il se passe à l’écran. L’une des scènes suivantes provoque également un certain trouble : alors que des habitants et touristes profitent des joies de la plage en plein jour, sous la surveillance du chef de la police, le requin attaque de nouveau et s’en prend à un jeune garçon sur son matelas gonflable. Cette fois-ci, alors que l’on n’aperçoit guère le monstre, les litres de sang se chargent de montrer toute la violence de l’attaque. Cruauté étonnante et audace suprême, dans la mesure où Spielberg met en scène frontalement la mort d’un enfant, chose assez rare (dans Munich, on se souvient de l’effort de l’un des agents du Mossad pour aller désamorcer une bombe qui menaçait un enfant).
Sur le plan scénaristique, si Jaws reprend certains des éléments du roman éponyme, Spielberg recentre son récit sur la chasse au requin, supprimant les aspects psychologiques des personnages, atténuant ainsi la noirceur du livre (la femme de Brody qui a une liaison avec l’océanographe Matt Hooper, le maire de la station balnéaire qui a des liens avec la mafia). La force du long métrage est donc de suggérer plutôt que de tout montrer, laissant hors-champ le plus sordide, ce qui permet aux spectateurs d’imaginer les choses. Un choix qui se révèle payant et d’une redoutable efficacité.
Enfin, il semble difficile de ne pas évoquer la musique du film. Après Sugarland Express, et annonçant une longue et fructueuse collaboration entre le musicien et le cinéaste (l’une des plus prolifiques de l’histoire du cinéma), John Williams signe une partition d’une grande modernité, qui participa pour beaucoup au succès colossal du film : un thème répétitif, fait de deux notes, associé aux multiples attaques du grand requin blanc. La combinaison musique/images filmées en caméra subjective place le spectateur en immersion, et ce, dès le générique signalant un danger à venir, une menace diffuse.
En définitive, loin d’être l’échec tant redouté, Jaws est devenu très rapidement un film culte, aux multiples références (le parallèle entre l’obsession du pêcheur Quint pour les requins et celle pour la baleine blanche de Achab dans Moby Dick) et interprétations (la nature contre les hommes ; critique du capitalisme et de l’individualisme…). Une œuvre qui installa définitivement son auteur dans le succès mais qui causa un traumatisme durable chez de nombreux baigneurs ou pour les requins dont l’image fut abimée et ce pour quelques longues années.
Xavier Affre
Rencontres du troisième type : Sol, La, Fa, Fa, Do

Sous le regard de curieux, des lumières colorées s’évanouissent dans un ciel orageux. Au loin, une ville s’illumine lentement, le temps reprend son cours. Pour les spectateurs de cette surprenante scène, c’est une nouvelle page qui s’ouvre : une image s’est imposée, elle va rapidement devenir une obsession, une fuite en avant. Bien que père et mari, Roy Neary échappe lentement aux siens. Comme les lumières, il ne laisse dans son sillage qu’incompréhension et grondement. Cette obsession, c’est aussi celle de Steven Spielberg qui, de 1977 à 2023, n’a cessé de graviter autour du thème de la famille. Avec Rencontres du troisième type, son quatrième long métrage métrage (cinquième en comptant la version cinéma de Duel), le cinéaste s’échappe des fonds marins et s’élève vers d’autres cieux. Un premier rendez-vous avec les extra-terrestres dans une carrière parsemée d’étranges rencontres avec des êtres venus d’ailleurs (pas toujours bien intentionnés).
En 1977, le Nouvel Hollywood, un mouvement inspiré par la Nouvelle Vague, se trouve à la croisée des chemins : il faut choisir entre la marginalisation ou le début de l’ère des superproductions. Quelques années avant la fin de cette brève parenthèse, deux jeunes cinéastes commencent déjà à scruter par-delà l’horizon : George Lucas et Steven Spielberg. La même année, ils sortent Star Wars et Rencontres du troisième type. La science-fiction, le cinéma de genre, est à l’honneur, c’est une rupture de ton et un changement important de paradigme. On se met à rêver d’un nouveau monde, le rêve américain de Ronald Reagan, passé d’Hollywood à la Maison-Blanche, approche.
Là où le film de Lucas se déroule dans une galaxie lointaine peuplée de différentes races d’extraterrestres, Rencontres du troisième type s’inscrit dans un contexte bien plus terre-à-terre. En Indiana, un réparateur de câbles, Roy Neary, est témoin d’un phénomène étrange dans le ciel. Son visage brûlé est autant marqué que son esprit : il doit comprendre ce qui s’est passé cette nuit. Une forme l’obnubile sans qu’il ne sache ce que c’est, ni où elle se situe. Ailleurs dans le pays, une mère cherche désespérément Barry, son enfant enlevé lors d’une nuit étrangement lumineuse. Enfin, le savant français Claude Lacombe parcourt le monde à la recherche de réponses : d’où vient ce cargo échoué dans le désert de Gobi, ces avions de la Seconde Guerre au Mexique, et ces entêtantes notes de musique ?
La réponse à ces questions se trouve quelque part dans l’ombre, dans le hors-champ. Comme dans Les Dents de la mer, Spielberg construit son film autour d’un paradoxal duo absence physique/présence permanente. Eblouis, les personnages ne peuvent voir ce qui se cache dans le halo, c’est à la fois un mystère et une invitation. Baigné dans la lumière, Roy se transforme en un Moïse en quête de sa terre promise. Pour atteindre son objectif, le père de famille doit se dépouiller de ce qui l’alourdit : son mode de vie, sa famille et sa maison. Un geste de destruction libérateur, sans remords, une véritable fuite vers un avenir impénétrable. Roy vit son rêve, quoi qu’il en coûte. Derrière ce comportement immature, on retrouve le thème de l’enfance, cher à Spielberg, mais aussi celui de la fragilité de la cellule familiale, gangrenée par un élément extérieur. On ne comprend plus le père de famille, qui agit et parle comme un illuminé, comme sous le coup d’une maladie qui ne dit pas son nom. La communication étant impossible, les liens se défont. Et c’est justement tout l’enjeu de Rencontres du troisième type : créer un langage commun.
Une thématique que l’on retrouve notamment dans Premier Contact de Denis Villeneuve. Dans l’oeuvre de Spielberg, ce sont cinq petites notes du compositeur John Williams qui nous permettent d’échanger avec nos visiteurs nocturnes. Un lexique épuré, pour ne rien dire de plus que l’essentiel. En haut d’un monolithe, la Devils Tower, l’entêtante musique transcende les frontières. Une conclusion mémorable, teintée d’innocence, où se rencontrent l’intime et le collectif, ici et au-delà. Les yeux dans le ciel, on rêve d’ailleurs.
Pierre Larvol
1941 : la guerre joyeuse

C’est la première fois que Spielberg traite dans son oeuvre de la Seconde Guerre Mondiale, thème qui deviendra prégnant dans ses films postérieurs. On la retrouvera ensuite jusqu’à la fin des années 90 dans Les Aventuriers de l’Arche perdue, Empire du Soleil, Indiana Jones et la dernière croisade, La Liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan. Pour se décomplexer par rapport à la gravité des faits historiques, Spielberg choisit de l’aborder sous l’angle de la farce, s’inspirant d’autres films complètement délirants, Hellzapoppin’ (comme par hasard, sorti en 1941) de H.C. Potter, Un Monde fou, fou, fou, de Stanley Kramer, The Party de Blake Edwards, ou encore Docteur Folamour de Stanley Kubrick (à qui il emprunte l’inoubliable interprète du commandant T.J. « King » Kong, Slim Pickens).
1941 est la première comédie de Steven Spielberg, survenant après l’énorme succès de deux blockbusters, Les Dents de la mer et Rencontres du troisième type. En 1979, Hollywood ne pouvait plus rien lui refuser et Spielberg se sentait sans doute comme un Dieu intouchable. Il choisit de mettre en scène ce scénario chaotique et abracadabrantesque de Robert Zemeckis et Bob Gale, deux talents qu’il avait repérés et qui s’illustrèrent quelques années plus tard dans la trilogie de Retour vers le futur. Or 1941, d’un point de vue historique, a contribué avec quelques autres films (Sorcerer de William Friedkin, La Porte du Paradis de Michael Cimino et Coup de Coeur de Francis Ford Coppola) à enfoncer les clous du cercueil du Nouvel Hollywood, ces films réalisant des bides retentissants et s’affichant surtout comme des caprices mégalomaniaques de cinéastes surdoués. Par rapport à ses illustres collègues, Spielberg n’était guère en retrait, dépensant tout l’argent de son budget à détruire des décors pharamineux et à utiliser le gadget de la Louma. C’est d’ailleurs la seule fois où il se laissa emporter par la folie des grandeurs, l’échec du film lui servant de cinglante leçon pour ses films futurs.
Pure comédie de Spielberg, 1941 a recours à un procédé narratif qu’il n’employa plus jamais par la suite : le récit polyphonique. En effet, l’histoire de 1941 fait s’entrecroiser sept saynètes, se déroulant après l’attaque japonaise sur Pearl Harbor et décrivant la panique à Los Angeles, suite à des menaces planant sur Hollywood : un pilote déjanté, « Wild Bill » Kelso (John Belushi) traque les avions japonais dans tout l’Ouest des Etats-Unis ; le général Stilwell (Robert Stack) minimise le danger japonais ; la secrétaire de Stillwell, Donna, n’arrive à atteindre l’orgasme qu’à bord d’un avion ; une bagarre homérique a lieu dans un dancing local, suite à une rivalité entre le caporal Sitarski et un plongeur dans un restaurant, Wally Stephens, au sujet d’une jeune femme, Betty ; sur la côte de Santa Monica, les Douglas (Ned Beatty et Lorraine Gary) voient à leur grand déplaisir le jardin de leur maison réquisitionné par l’artillerie ; enfin un sous-marin japonais, avec à son bord un officier nazi, longe cette même côte, de manière menaçante. Pour Spielberg, la structure chaotique de ce scénario devait contribuer à exprimer le chaos de l’histoire. Or les critiques de l’époque l’attendaient au tournant et ont, avec une rare unanimité, rejeté son film. Commercialement, il a fini par rentrer dans ses fonds, grâce aux recettes à l’étranger et aux ventes vidéo.
Il faut souligner qu’en l’absence de vedettes charismatiques et avec au contraire la présence alcoolisée de John Belushi qui déstabilisait le tournage, Spielberg manquait d’un centre névralgique qui aurait permis à 1941 d’affronter les critiques. Pour la plupart, 1941 se résumait à un délire hystérique, une cacophonie sans nom où les spectateurs étaient parfois obligés de se boucher les oreilles, étant donné le déluge sonore d’explosions, de cris et de hurlements qu’ils recevaient. Spielberg ne s’est d’ailleurs pas privé d’en rajouter au générique de fin, en filmant la présentation de chaque acteur en train de hurler. Pourtant les moments d’anthologie ne manquent pas dans ce film brillamment mis en scène : le passage surréaliste où le général Stilwell stoppe tout pour aller voir Dumbo au cinéma ; les tentatives de Donna, sa secrétaire, pour atteindre l’orgasme en plein vol ; la bagarre homérique suite au concours de jitterbug (premier moment de comédie musicale chez Spielberg, bien avant West Side Story), rappelant une autre bagarre mémorable dans L’Aigle vole au soleil de John Ford ; la destruction de la maison des Douglas et du parc d’attractions voisin dont la grande roue finit par atterrir dans l’Océan Pacifique, etc.
Au moins à deux reprises le film est signé de façon indubitable par Spielberg : lorsqu’un train miniature fonce sur un visage cf. The Fabelmans, et lorsque Donna et son pilote atterrissent dans le parc d’attractions, nez-à-nez face à une affiche de dinosaures. Pendant longtemps, Spielberg a passé sous silence ce film, n’en parlant jamais et le considérant comme le plus grand échec de sa carrière. Or, avec le temps, 1941 apparaît surtout comme un immense plaisir régressif, un rare délire jubilatoire, d’autant plus précieux qu’il est totalement excessif. C’est quasiment devenu un classique de la comédie, que l’on rangera désormais aux côtés de Hellzapoppin, Un monde fou, fou, fou, The Party, Playtime ou Docteur Folamour.
David Speranski
E.T. l’extra-terrestre : E.T.ernellement…

1982, Steven Spielberg a 36 ans, et, après la terreur du requin blanc sorti de l’océan pour dévorer les humains (Les Dents de la mer en 1975), l’arrivée d’aliens sortis de l’espace de leur soucoupe volante (Rencontres du troisième type en 1977), c’est au tour d’un extra-terrestre attendrissant de devenir une star plus réputée encore que n’importe quelle autre étoile humaine de chair et d’os. Ce depuis plus de quarante ans. Ce pour notre plus grand plaisir, notre souvenir, notre doudou éternel (en ce qui me concerne j’avais acheté sa peluche !) : il s’appelle E.T. Pourtant, le film de notre héros ne s’apparente qu’à une sorte de buddy movie tourné du côté de la science-fiction, le pote du duo de copains étant une créature perdue sur la Terre. En effet, le film raconte la rencontre et le lien qui se créent entre Elliott – interprété par Henry Thomas et dont l’incarnation et la naïveté ne sont pas sans faire penser à Gabriel LaBelle interprétant Sammy soit Steven Spielberg lui-même dans sa dernière œuvre autobiographique, The Fabelmans –, la dizaine au milieu de sa fratrie de trois enfants sans leur papa, et E.T., arrivé et découvert par lui dans sa banlieue américaine, où ce dernier s’ennuyait quelque peu… entre enfants ou adultes, isolé qu’il était, à attendre que quelque chose se passe. Qui se passe et pas des moindres ! S’en suivront la protection de l’extra- humain E.T. tel que la petite sœur Gertie (Drew Barrymore devenue célèbre) l’a nommé, avec qui Elliott entrera en osmose (physique et psychique), son apprentissage du langage humain, car il parvient à (nous) comprendre et à (se) faire comprendre, le récit de ses (nos) expériences humaines (telles un Halloween), sa maladie, sa récupération par le gouvernement. Entre les rires et les larmes successifs évoqués par les situations dans lesquelles se trouve E.T. et le fait que le spectateur puisse s’identifier tour à tour au petit monstre ou à son protecteur, c’est un happy end comme sait les faire le cinéaste, car on ne casse pas les rêves d’enfant (de réalisateur !) comme ça : ressuscité de la mort, le cœur rouge et battant, l’index lumineux et protecteur, notre bébé à tous finira par s’envoler vers ses cieux familiers sous le regard et les larmes de tous ceux qui l’ont côtoyé…
En faisant la part belle à l’imaginaire, à la manière d’un conte, à faire que l’alien (s’) illumine le cœur des enfants (mais pas que), E.T. l’extra-terrestre pose d’abord les non-limites du pouvoir : pouvoir d’un cinéaste d’abord avec sa capacité à renouveler le genre de la science-fiction et les films d’aliens avec leurs types destructeurs attendus, en leur attribuant ici une fonction thérapeutique et non conflictuelle : « pacifiction » ! ; pouvoir des enfants, qui si on le connaissait déjà en opposition à celui des adultes, vient montrer comment ils peuvent se désolidariser de leurs modèles familiaux : déculpabilisation ; pouvoir du cinéma enfin, capable de démultiplier ses effets (et déjà ses budgets) pour fabriquer trois animatroniques, faits de costumes de 20 kilos, interprétés par des acteurs pas comme les autres (l’acteur Pat Bilon mesurant 86 cm ou le mime Caprice Roth pour l’usage de ses mains dans des gants imitant la peau d’E.T.). On peut d’ailleurs rappeler, pour la petite histoire et la Grande du coup, que les designers se sont inspirés du scientifique Albert Einstein ou du poète Cat Sandburgh : pouvoir évocateur donc et prompt à nous rendre un Autre plus proche et familier qu’un des nôtres… Cette nouvelle vision de l’extra-terrestre comme la nouvelle vision de l’attitude humaine, le premier perdant sa famille, le second ne possédant pas de modèle paternel, et alors que ce sont deux mâles, est déjà une manière de parler des hommes autrement : si Keys (Peter Coyote) joue le rôle du méchant, même en hors-champ avec pour symbole ses clés, les jeunes enfants ici ne cherchent pas à imiter ceux qui jouent aux grands en faisant la guerre, en surveillant, en faisant peur à ceux qu’ils craignent mais ils se retrouvent, naïvement, humainement, simplement à protéger un Autre, et à faire preuve de tendresse. Steven Spielberg a montré tout au long de sa carrière qu’il était un cinéaste placé du côté des bons et beaux sentiments – tout à fait bibliques au passage, notamment avec l’affiche et sa reprise du tableau de la création d’Adam par Michel-Ange –, luttant à sa manière contre toute forme de racisme ordinaire, et il vient, avec E.T. l’extra-terrestre, faire vivre des attitudes et éprouver des sentiments en voie de disparition : la découverte, la rencontre, la différence, l’innocence et le caractère bienfaiteur pour lutter contre les comportements discriminants s’érigent contre le rejet, la peur, la propagande, la supériorité et le caractère prédateur qui s’en suit – même si les enfants n’échappent pas à la possession et indirectement à la surveillance en enfermant leur trésor. Mais comment ne pas préserver ce trésor trouvé, notre petit trésor à tous, car il nous fait nous souvenir de nos secrets enfantins les plus inavoués? Jeu sur le passé et le futur, ce qui existe encore et ce qu’on a perdu, pour quel discours ? – limiter la violence – : rappelons aussi que Steven Spielberg lui-même a fait machine arrière avec l’usage des talkies-walkies que tenaient les policiers à la recherche de l’alien perdu à la place d’armes (des pistolets) qui réintègreront l’image dans l’édition du Blu-ray, des choses qui restent, d’autres qui partent tels ces objets d’un autre temps. C’est qu’à la logique du film américain était aussi venue répondre la logique affective : comment des adultes pourraient-ils braquer leurs armes sur des enfants ? Pourtant, contre une image qui fait s’envoler vers le ciel à pleine lune un enfant sur son vélo, aucune arme ne peut rien… Pour la petite histoire encore, on peut rappeler que le travail de création de la scène d’envol entre Elliott et E.T. devenue mémorable, fut un casse-tête, ce malgré l’usage d’effets spéciaux : trouver le bon spot pour capturer une pleine lune la plus proche de la Terre tout en juxtaposant les images sur le vélo de l’enfant. L’image figurera finalement le logo d’Amblin Entertainment,la société de production de Steven Spielberg, c’est bien l’histoire d’une madeleine, d’une continuité, celle de nos années, passées à se remémorer non pas combien c’était mieux avant mais comment aujourd’hui et demain peuvent s’inspirer du bon vieux temps, de sa joie et faire du cinéma, même quarante plus tard, toujours un recommencement.
E.T. l’extra-terrestre a été en effet remis à l’honneur, grand bien lui a fait, lors de son arrivée sur Netflix, fin 2020, une histoire de COVID : c’est encore pas mal de la part d’un film réalisé tant d’années plus tôt d’évoquer autant de définitions du confinement sans le vouloir ! En effet, c’est d’abord l’histoire du confinement d’une créature, dans un espace qui n’est pas le sien avant d’être confinée dans un placard pour lui éviter de se faire capturer (virussé ?), quand sont inversement montrés comme confinés des esprits incapables de tolérer un extra-terrestre inoffensif, ou déconfinés dans le cas des enfants qui tentent, eux, de se rapprocher d’un être qui n’est pourtant en rien l’un des leurs, et d’en faire un ami, de lui apprendre à parler et de l’aider à retrouver les siens… Solidarité. La question de l’enfermement jusqu’à l’emprisonnement a toujours été présente dans le cinéma de Steven Spielberg, et, comble du comble, il choisit, dès son plus jeune âge, d’enfermer à son tour les images qui passent devant ses yeux ou dans sa tête, dans une boîte noire, sauf que, par chance, celle-ci vivra la reproductibilité… devenant presque infinie ou éternelle, au choix. Cette question de l’étendue temporelle trouve aussi son répondant dans celle des territoires (eux-mêmes renvoyant aux classes sociales, origines, identités), déjà présente dans le film, ne serait-ce que par l’opposition des topos Terre/Cosmos, que le cinéaste tente de relier : même si on reste prisonnier de nos souvenirs et des émotions qui y sont liées, comment ne pas garder la phrase d’E.T. s’envolant vers chez lui « je suis toujours là ? » à l’esprit ? Territoires d’images, passant par le visuel comme le sonore, au titre de la réminiscence encore. Et, toujours là, c’est encore George Lucas qui, dans l’épisode 1 de Star Wars, La Menace Fantôme, intégrait, 17 ans plus tard, des aliens à l’image d’E.T. dans une scène se situant au cœur d’un Sénat galactique ! Alors on peut se demander ce qui fait que les films de Steven Spielberg, on les aime, et particulièrement celui dans lequel un Autre que nous-mêmes s’est perdu sur la planète Terre : ne serait-ce pas une des questions primordiales dans la réception du cinéma que celle de l’identification ? à nous faire aussi nous questionner sur notre identité… Qui serait au fond l’extra-terrestre ? E.T, Elliott au sein de sa propre famille, chacun d’entre nous, ou bien même le cinéaste lui-même : venu d’ailleurs, passé sur Terre, toujours en partance vers d’autres territoires d’images, d’autres mondes à remonter le temps ou à faire surgir le futur, son « épopée minuscule », comme Steven Spielberg avait caractérisé lui-même son film, devenue grande aujourd’hui eu égard à l’œuvre accomplie, a rendu éternel E.T., même parti dans son cosmos infini ! Mieux que l’identification, la conscience, c’est que le cinéaste avait déjà bien compris que la Nature, il fallait la chérir plutôt que de la détruire, comme il avait prédit que la nature humaine avait bien moins à conquérir que de s’enrichir auprès de ceux qui ne sont pourtant pas elle. Preuve de la force de son cinéma et de fonction de cinéaste au monde, E.T. c’est lui, et comme avait dit Isidore Ducasse dit le comte de Lautréamont en surréaliste de son temps, le film est « beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie… » et marque(ra) les temps, E.T.ernellement…
Ana Hyde
La Couleur pourpre : une première incursion réussie dans le drame historique

Sorti en 1985, ce magnifique film marque un tournant dans la carrière de Steven Spielberg. Après s’être brillamment essayé au thriller (Duel), l’horreur (Les Dents de la mer), la science-fiction (E.T L’Extraterrestre, Rencontres du troisième type) et l’aventure (trilogie Indiana Jones), La Couleur pourpre est la première œuvre à s’éloigner des codes habituels du cinéaste, faits de divertissement et d’émerveillement, lui qui aime si fort les images fixes qui bougent et proposait jusqu’alors un cinéma conforme à ses rêves d’enfant passionné par la pellicule. Dans son dernier film, The Fabelmans, le cinéaste américain explique ce qui l’anime, cette passion dévorante pour le Septième Art. Après avoir régalé les rétines de plusieurs millions de spectateurs, à travers ses films cultes, Spielberg se réinvente, d’excellente manière, pour devenir un véritable conteur d’histoires, complétant ainsi une palette de metteur en scène déjà accompli. Ce film mettant en scène Whoopi Goldberg devient le premier essai dans un nouveau genre, le drame historique. Nommé dans plusieurs catégories aux Oscars 1986 (sans récompenses), ce récit narrant l’histoire de ces deux sœurs séparées se transforme en une fresque historique puissante, dans une Amérique au double visage, marquée profondément par le racisme, et où la condition des femmes de couleur est explicitée avec dureté, montrant une soumission à la domination masculine.
Nettie et Celie vivent sous l’autorité d’un patriarche autoritaire leur manifestant que peu d’intérêt. Ce père indigne les sépare honteusement. Pendant de nombreuses années, Celie subit violence et mépris, tout en gardant un espoir de retrouvailles.
Steven Spielberg se change en cinéaste de la dramaturgie, à une époque où son cinéma proposait un spectacle misant sur le divertissement. En racontant les trajectoires de Nettie et Celie, son style s’affirme encore plus, tout en se réinventant, et ce film aux accents humains et dramatiques n’est que l’entame d’un cheminement cinématographique différent qui va donner lieu à de multiples productions de qualité, plus variées, telles que La Liste de Schindler ou Il faut sauver le soldat Ryan.
La Couleur pourpre, injustement mésestimé, possède toute la matière d’un chef-d’œuvre dont la maîtrise est incontestable. Dès les premiers instants du film, la mise en scène inonde de sa beauté ces paysages de champ de coton à perte de vue, magnifie cette relation paraissant indestructible entre ces sœurs dont la grande complicité saute aux yeux, dans un environnement dur, peu propice aux épanouissements. La beauté relative de ces scènes montrant ce lien fort, contraste cependant avec les complications de la vie quotidienne, dans un univers dominé par une forme d’esclavagisme, de soumission, et par une inéluctable séparation orchestrée par un père peu aimant mettant la toute jeune Celie dans les mains brutales de Monsieur Johnson (Danny Glover). Dès lors, le film rentre dans une autre dimension, plus dramatique et poignante. Ce début réussi se compose tout de même de certains codes chers à Spielberg, celui de l’enfance, de ce monde enfantin qu’il aime tant, même si celui décrit dans ce film diverge et présente des connotations plus tragiques. Néanmoins, la proximité de ces sœurs, faite d’une débordante affection cachant la misère de leur condition, expose encore ce sentiment de magie si abondant dans les films d’avant. Ce côté magique s’estompe, laissant place au romanesque, dans ce qui est une fresque humaine aussi attachante que terrifiante. La Couleur pourpre évoque beaucoup de choses, pas seulement des destinées différentes, mais également la condition des femmes, soumises aux hommes ou subissant les difficultés d’une Amérique gangrenée par la haine raciale. Spielberg nous plonge complètement dans cette histoire, dans une communauté faite de personnes de couleur vivant autour de ces champs de coton, un milieu ressemblant à un microcosme différent où les joies se mêlent à la douleur indicible de Celie. Celle-ci, sous l’emprise de la violence, s’assujettit. Toute la force de Spielberg réside ici dans la mise en lumière de ce rapport dominant/dominée où nous sentons un personnage féminin enfermé, se raccrochant au moindre espoir de retrouver sa sœur. Le metteur en scène explique la domination de la virilité masculine, de cette violence mortifère, thème qui traverse fortement tout le film et crée indéniablement un grand sentiment d’affection et d’attachement. Durant 2 h 34, le scénario déroule son récit se tissant autour de cette douloureuse séparation, laissant place à une dramaturgie encore jamais vue auparavant. La relation remplie de haine et de vengeance, entre cet homme brutal et cette femme fragile, est au cœur du développement, et c’est la première fois qu’un contact aussi sauvage, violent apparaît dans la filmographie d’un cinéaste qui aime les rapports humains simples et non complexes.
La Couleur pourpre est un film déterminant dans sa carrière. En effet, il lui permet de toucher à un registre moins spectaculaire et plus dramatique, et le faiseur de magie devient un conteur formidable. Une galerie de personnages s’offre à nous, décrivant chacun une part de l’histoire des États-Unis, entre les rudesses du travail du coton, et Sofia (Oprah Winfrey), symbole du racisme ambiant et de l’asservissement. Le film trouve sa puissance dans la dénonciation des oppressions raciales et sexuelles, à une époque où les femmes ont une infime influence sociale. En parcourant plusieurs décennies, le film retrace ainsi l’évolution des conditions, des mentalités, collant à la réalité historique. Adaptation d’un roman d’Alice Walker, censuré pour ses passages sexuellement et verbalement explicites, ce long-métrage, sans toutefois verser dans le malsain, se révèle être d’une grande puissance psychologique, bénéficiant d’une tension permanente. L’ensemble de l’œuvre, malgré le contenu dramatique, comporte une note d’espérance, celle d’une communauté avide de liberté et de jours meilleurs, désireuse de s’élever socialement et de pouvoir s’affranchir du pouvoir des Blancs.
Sylvain Jaufry
Empire du Soleil : la mort de l’innocence

Longtemps Empire du Soleil a été un mal-aimé de la filmographie de Spielberg, la faute certainement à un personnage principal d’enfant mal-aimable, gâté et souvent insupportable, interprété magistralement par un Christian Bale pré-adolescent. Pendant une période qui s’est prolongée, jusqu’au début du XXIème siècle, Empire du Soleil était considéré comme une étape intermédiaire vers le cinéma adulte que Spielberg souhaitait maîtriser, une deuxième étape après celle initiée par La Couleur Pourpre, et qui allait conduire vers l’accomplissement de La Liste de Schindler. Or, avec le temps, Empire du Soleil apparaît de plus en plus comme le centre névralgique de l’oeuvre de Spielberg, le film où l’enfant effectue sa transition vers sa vie d’adulte, via les différents moments d’une lutte pour la survie, le film de la mort de l’enfance, du deuil de l’innocence.
Pourtant, à l’origine, Empire du Soleil n’était pas destiné à Spielberg mais à David Lean, avec qui Spielberg était devenu ami, en participant à la restauration et la ressortie de Lawrence d’Arabie. David Lean, en raison de son grand âge et d’un autre projet, l’adaptation de Nostromo de Joseph Conrad, qui ne vit jamais le jour, dut abandonner Empire du Soleil. En le reprenant, Spielberg y vit l’occasion de rendre hommage à son maître en s’inspirant de son style opératique et à grand spectacle, et de faire progresser son oeuvre. En adaptant le roman éponyme et autobiographique de James G. Ballard (où l’auteur y révélait les sources d’inspiration de ses romans d’anticipation, soit l’occupation japonaise de la ville de Shanghai), Spielberg poursuivait sa thématique très personnelle des enfants perdus qui allait proliférer ensuite avec A.I., intelligence artificielle et Arrête-moi si tu peux.
Dans Empire du Soleil, Jamie, l’enfant gâté-pourri, va apprendre à survivre tant bien que mal. Tout commence par cette séparation déchirante d’avec sa mère, avec en toile de fond, l’une des plus belles scènes de foule tournées par Spielberg, avec celles de La Guerre des mondes. Dans un plan bouleversant, il suffit que Jamie se penche pour ramasser son avion miniature, symbole de son enfance persistante, pour qu’il perde la main de sa mère, et se retrouve irrémédiablement seul. Dans un récit à la Dickens, il va trouver un père de substitution, Basie (le troublant et ambigu John Malkovich), qui lui apprendra les règles de la survie, en passant par un peu de malhonnêteté et de délinquance. Quelques temps plus tard, il trouvera aussi une mère de substitution, Mme Victor (Miranda Richardson) qu’il verra presque faire l’amour avec son mari, dans un remake de la scène originelle oedipienne.
Christian Bale, exceptionnel dans son premier rôle, ne sourira quasiment jamais de tout le film, exactement comme Jean-Pierre Léaud dans Les Quatre Cent Coups de Truffaut, donnant consistance à son personnage de sale gosse pourri, qu’on prend pourtant en pitié, tant les événements de la Seconde Guerre Mondiale se liguent contre lui. La miséricorde qu’on lui accorde est d’autant plus forte que Jamie n’essaie jamais d’être émouvant, déployant une suractivité agaçante (à l’image sans doute de Spielberg enfant) en voulant s’occuper de tout le monde. Jamie croit avoir des dons surnaturels et pense pouvoir sauver tout mourant. Il échouera pourtant à deux reprises à le faire, envers une patiente du Docteur Rawlins et un jeune soldat japonais avec qui il a sympathisé et qu’il n’arrivera pas à faire revenir à la vie, suite à une balle tirée à bout portant, par un des acolytes de Basie. Spielberg montre sans fards l’immaturité de Jamie lorsqu’il croit voir en l’explosion de la bombe atomique d’Hiroshima l’âme de Mme Victor monter au ciel. Cette prise de distance est peut-être due au statut récent de père qu’a acquis Spielberg (il est devenu le père de Max quelques années auparavant). Avec la lumière blanche de la bombe d’Hiroshima, ce n’est pas seulement la mort de l’innocence de Jim mais celle d’un monde tout entier qui s’effondre, Spielberg réussissant à mettre en parallèle sans difficulté la vision de l’enfant et celle d’un monde en totale déliquescence. Contrairement à ce qui se passe dans E.T., Spielberg ne s’identifie plus complètement à l’enfant. Depuis lors, les enfants perdus de sa filmographie seront toujours vus d’un oeil critique, même s’ils s’avèrent être les points de repère autobiographiques de son oeuvre.
Dans Empire du Soleil, les plans d’ensemble sont souvent somptueux, témoignant du sens du paysage et du cadre de Spielberg, avec ce placement très sûr de la ligne d’horizon, chèrement appris chez John Ford. En témoignent cette séquence au début lors d’une réception, où Jamie découvre une armée de Japonais au-delà d’une colline, ou encore cette autre scène hallucinante de l’entrepôt à ciel ouvert des richesses laissées par les Anglais qui ont fui Shanghai, sorte de déversoir de toutes les souvenirs d’une époque défunte. A la fin du film, Jamie retrouvera ses parents mais Spielberg a l’habileté de ne pas filmer la scène comme une happy end. Cheveux courts, regard vide, Jamie a l’air d’avoir pris dix ans de plus et ne reconnaît même pas ses parents. Lorsqu’il finit par serrer sa mère dans ses bras, il réagit de manière mécanique et presque sans affects, de manière bien plus désincarnée que David dans A.I. A la fin, flottera sur le fleuve la valise de Jamie, celle qui l’a accompagné pendant tout son long périple vers la survie, et qui contient tous ses souvenirs d’enfance. C’est en cela que Empire du Soleil est l’un des plus beaux films de Spielberg, il nous montre comment l’enfance meurt, de quelle manière elle disparaît sans laisser de traces.
David Speranski
Jurassic Park : la vie trouve toujours un chemin

Comment ne pas penser à Spielberg, aux années 90 et à un blockbuster sans avoir en tête la mythique scène de l’apparition du T-Rex sous la pluie ?
Nous sommes en 1993, Steven Spielberg compte déjà plus de 15 films à son actif, et sort tout juste d’un tournage plutôt fastidieux avec Hook ou la revanche du capitaine Crochet. Il se lance alors dans la production de ce qui deviendra l’un de ses films phares : Jurassic Park. Le défi est pourtant de taille : comment rendre vivant des êtres ayant vécu il y a plus de 65 millions d’années sans rendre le tout ridicule ? Il sera pour cela épaulé par Phil Tippett, pour les modèles réduits de dinosaures, Stan Winston, pour les animatroniques géantes, ainsi que Dennis Muren travaillant pour Industrial Light & Magic (ILM) pour la représentation en images de synthèse. C’est d’ailleurs en voyant les premiers résultats de cette démonstration par ordinateur que Spielberg sera bluffé et voudra donc utiliser cette méthode pour marquer le spectateur. Avant ce film, les dinosaures n’avaient jamais été représentés de manière aussi réaliste à l’écran. Le travail effectué par ILM, la société de George Lucas, a permis de créer des animaux préhistoriques qui semblaient vivants. Les mouvements, les textures et les détails des dinosaures étaient si réalistes qu’ils semblaient vraiment présents à l’écran. Le réalisme de ces dinosaures a permis au public de s’immerger dans le monde de Jurassic Park et de vivre l’expérience avec les personnages.
Ce film d’aventure et de science-fiction est un exemple brillant de la façon dont le cinéma peut transporter les spectateurs dans un autre monde. Le scénario est basé sur le livre de Michael Crichton, ayant aussi coécrit le scénario du film avec David Koepp. L’histoire se déroule sur Isla Nublar, une île non loin du Costa Rica, où un milliardaire excentrique, interprété par Richard Attenborough, a créé un parc à thème rempli de dinosaures clonés. Lorsque les choses tournent mal et que les dinosaures s’échappent de leurs enclos, les personnages doivent faire face à des dangers mortels tout en essayant de survivre.
Jurassic Park est un regroupement des thèmes de prédilection de Spielberg : l’enfance, la famille, l’Homme face à la Nature, la critique du capitalisme, les dérives de la technologie… L’histoire est racontée de manière cohérente et logique, et le suspense est maintenu tout au long du film. L’action, le montage et la mise en scène offrent des moments de tension élevée pour les spectateurs. Et c’est d’autant plus incroyable quand on sait que les dinosaures n’ont qu’environ 15 minutes de temps d’apparition à l’écran. En limitant leurs apparitions, Spielberg arrive à nous offrir des scènes devenues cultes : le verre d’eau qui tremble annonçant l’arrivée du T-Rex, les ombres des vélociraptors projetées sur les murs…
La musique de John Williams est un autre point fort de Jurassic Park. La partition orchestrale de Williams est devenue emblématique et est instantanément reconnaissable. La musique accompagne parfaitement les scènes, créant ainsi une expérience cinématographique émotionnelle.
Enfin, Jurassic Park a su marquer son temps et continuer à séduire de nouvelles générations de spectateurs. Depuis sa sortie en 1993, il a été réédité en 3D et a inspiré plusieurs suites et spin-offs, ainsi que des attractions dans les parcs à thème. Il est devenu un classique du cinéma de science-fiction, un film qui a émerveillé et effrayé des millions de personnes à travers le monde.
Jurassic Park reste l’un des chefs-d’œuvre de la carrière de Spielberg. Il a captivé des millions de spectateurs à travers le monde grâce à ses effets spéciaux novateurs, son intrigue passionnante et son casting de talentueux acteurs. Tout ceci en fait un de mes films préférés du réalisateur. Divertissant, le résultat est un film d’action palpitant qui suscite la réflexion et reste gravé dans l’esprit des spectateurs.
Quentin Eluau
La Liste de Schindler : le petit Chaperon rouge
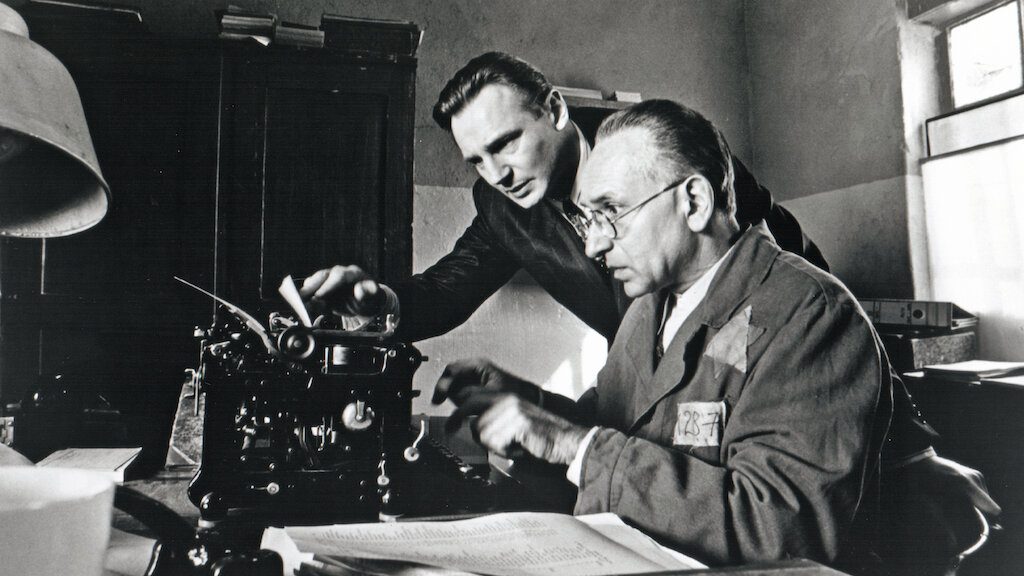
Après La Couleur pourpre et Empire du Soleil, snobés par l’Académie des Oscars, La Liste de Schindler représente l’aboutissement de cette veine « adulte » du cinéma de Spielberg, avec un total de sept Oscars à la clé. Aujourd’hui, La Liste de Schindler est le film le plus admiré et respecté de l’oeuvre de Steven Spielberg (film classé numéro 8 dans une autre liste, celle des 100 meilleurs films américains, décrétée par l’American Film Institute), à défaut d’être sans doute le plus aimé. Pourtant rien n’allait de soi pour cette adaptation du livre de Thomas Keneally. Depuis l’achat des droits fin 1983, Spielberg a plusieurs fois reculé devant l’obstacle, craignant de manquer de maturité, essayant plusieurs fois de refiler ce projet de film à Sidney Pollack, Martin Scorsese, Roman Polanski ou encore Billy Wilder, Finalement neuf ans plus tard, Spielberg a compris que son destin le menait inéluctablement à la réalisation de ce film. Personne d’autre n’aurait pu le tourner mieux que lui.
Néanmoins, pour y parvenir, il a fallu qu’il change radicalement de style. Au revoir les beaux mouvements de caméra, amples et lyriques de Empire du Soleil, finies les teintes chatoyantes de La Couleur Pourpre. Place désormais au noir et blanc sec et documentaire, à la caméra à l’épaule dans le plus pur style des reportages d’actualité, au montage abrupt, rapide et dénué du moindre pathos. Ce changement de style est certainement le coup de génie du film. Spielberg le doit à sa rencontre avec Janusz Kaminski, son nouveau directeur de la photographie, avec qui il entamera une collaboration de longue durée qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Contrairement à Allan Daviau, le précédent directeur de la photographie de Spielberg, responsable des superbes images de E.T., La Couleur Pourpre et Empire du Soleil, Kaminski choisit un traitement beaucoup plus dur de l’image, réaliste et dépourvu de joliesses. Le choix déterminant du noir et blanc plonge d’emblée dans le cauchemar de la Seconde Guerre Mondiale, Kaminski parvenant à atteindre le sublime sans chercher à faire de belles images. Les prises de vues et le montage haché nous font participer à une atmosphère intense, oppressante et étouffante qui est pour beaucoup dans la réussite du film.
Ce terrible noir et blanc, synonyme de désespoir, est juste troublé par la présence d’une petite fille au manteau rouge, symbole de la prise de conscience de Schindler, au moment de la rafle dans le ghetto de Cracovie. Cette petite fille, seul Schindler semble la voir, métaphore de son chemin de Damas. Cette couleur rouge est exactement la même que celle de la voiture de Duel : doit-on voir dans ce choix de couleur, symbole prégnant de l’individualité contre la machine, qu’elle soit mécanique ou nazie, un simple hasard? Entre Spielberg et Schindler, l’identification est totale, cf. le même nombre de lettres dans leur nom. Oskar Schindler (immense Liam Neeson dans tous les sens du terme), homme d’affaires nazi, est traversé d’un seul coup par une illumination morale, alors qu’il exploitait les Juifs dans ses usines d’armement et de matériel de cuisine, tout comme Spielberg a décidé de tourner ce film, alors qu’il récoltait des sommes incroyables d’argent avec ses premiers blockbusters. La force du film tient à ce qu’il ne cherche absolument pas à expliquer le comportement de Schindler, celui-ci restant jusqu’au bout une énigme. La bonté est un mystère. Pendant que les exécutions sommaires de Juifs se multiplient autour de lui, Schindler navigue à vue entre deux personnes représentatives des deux pôles de sa personnalité, le Bien et le Mal : Isaak Stern, le petit comptable juif, magistralement interprété par Ben Kingsley, et Amon Goeth, l’officier nazi, cruel et sardonique (impressionnant Ralph Fiennes, découvert spécialement par Spielberg pour l’occasion). Il eût été facile pour Spielberg de forcer le trait et de faire d’Amon Goeth un véritable monstre, ce que, pour certains, il est déjà. Pourtant, même lui, qui s’amuse à tirer à bout portant sur les prisonniers de son camp, possède ici sa part d’humanité, son amour sans espoir pour sa servante juive, Helen. Une attirance irrationnelle, imprévisible, paradoxalement émouvante.
Le film fonctionne de manière cumulative : les morts s’amoncellent ; Schindler ne cesse de tromper sa femme, en entretenant diverses liaisons ; certains Juifs sont sauvés de la barbarie de manière occasionnelle par Stern ou Schindler. Le décompte entre morts et vivants demeure ainsi fondamentalement inégal et pourtant c’est ce que va retenir Spielberg, preuve de son incurable optimisme : les personnes sauvées et non la tragédie de l’Holocauste. « Celui qui sauve une vie sauve l’humanité tout entière« , cette phrase du Talmud deviendra le message de La Liste de Schindler : retenir dans ce monde chaotique les actes de bonté et non la propagation du Mal. Les formidables scènes où Schindler, cigarette au bec, dicte les noms de sa liste à Isaak Stern, sont déjà entrées dans la légende du cinéma mondial, se concluant par ces mots définitifs de Stern : « cette liste, c’est la vie« .
Pourtant, La Liste de Schindler n’est pas, en dépit de ses nombreuses réussites (en particulier une reconstitution poignante de la rafle dans le ghetto de Cracovie, moment d’anthologie du film pendant quinze minutes), complètement exempt de défauts. Deux ou trois séquences paraissent un peu en-dehors du film et ont parfois créé la polémique. La séquence où des femmes de la liste de Schindler sont victimes d’un mauvais aiguillage de train et se retrouvent par accident à Auschwitz, a déclenché le courroux de certains cinéphiles et cinéastes dont Claude Lanzmann, l’auteur de Shoah, au sujet de l’impossibilité de la représentation des chambres à gaz. Spielberg joue ici d’un suspense hitchcockien qui peut sembler de fort mauvais goût, si ce suspense n’était conforme à une vérité historique accréditée par les survivantes de la liste de Schindler. Le tort de Spielberg consiste à avoir voulu se montrer trop fidèle aux faits et témoignages des Juifs de Schindler et de n’avoir pas pris conscience du mauvais goût inhérent à la situation et des accusations qui pouvaient être occasionnées par celle-ci. Une autre séquence où Schindler se lamente de n’avoir pas sauvé plus de vies paraît assez puérile et manque à l’évidence de sobriété, alors que tout le film se caractérise auparavant par sa pudeur et son absence d’exhibitionnisme mélodramatique. Enfin, la toute fin du film, passant à la couleur et à une longue et interminable procession de membres de la liste de Schindler accompagnés des acteurs qui les ont interprétés, posant chacun une pierre sur la tombe d’Oskar Schindler, joue un peu à l’encontre des trois heures qui l’ont précédée et nous sort du film, à proprement parler, en virant à l’hagiographie. Néanmoins, tous comptes faits, ces quelques moments mis bout à bout ne pèsent pas grand-chose par rapport aux trois heures extraordinaires de La Liste de Schindler, un immense morceau de cinéma et d’Histoire reconstituée.
David Speranski
A.I. intelligence artificielle : Pinocchio 2000

Pinocchio 2000, ou bien, les intermittences du goût. Apprenez que lorsque je le vis pour la première fois, je détestai ce gros pudding sentimental, orné des flonflons émotionnants de John Williams. Que les amateurs de Spielberg ne me fassent pas tout de suite sortir de leur bureau, apprenez aussi que peu de temps après, votre humble serviteur changea d’opinion. Lui restait en tête un souvenir pas loin d’être bouleversant — la fin est un truc de dingue, du jamais vu, allait-il jusqu’à s’entendre s’exclamer in petto, voyant simultanément son index se lever en direction du plafond. Il faut avouer que la représentation de l’exaucement d’une prière, c’est toujours beau, n’importe quel quidam espérant vous le confirmera. Je dirais même plus, plus l’espérance dure longtemps, plus c’est beau. Mais bon, on n’est quand même pas chez Dreyer, les flonflons sont toujours là, et les aliens en pixels moches aussi, comme j’ai pu le constater à cette nouvelle vision. Pour ne rien arranger, à certains moments j’entendis, dans le voisinage de la personne chère à mon cœur — elle ne l’avait jamais vu, je me faisais une joie de lui faire découvrir ce film on ne peut plus adapté à l’esprit de Noël —, de brefs mais incontestables ricanements. Oui, vous avez bien lu — à tel point que je n’osai presque pas verser ma petite larme, quand la mère indigne abandonne son enfant artificiel, puis quand apparaît la Fée bleue. Entre ces deux épisodes, il faut se farcir un clip de Ministry. Mais laissons ces bêtises, et concluons sérieusement. C’est quand même pas mal comme film, Haley Joel Osment aux ossements métalliques est parfait — mémorable scène dite des épinards —, et j’aime bien le fait que le sous-texte sexuel bien connu du conte de Collodi soit malicieusement incarné par Jude Law, AKA Gigolo Joe et sa bite probablement en bois.
Poulet Pou
Quand on regarde aujourd’hui A.I. Intelligence Artificielle, sorti en 2001, on peut s’étonner de voir à quel point le film devançait son époque et annonçait la nôtre. Le film commence ainsi : « C’était après la fonte des calottes glaciaires dues aux gaz à effet de serre. Les océans avaient recouvert tant de villes, le long des côtes du monde. Amsterdam, Venise, New York, disparues à jamais…Des millions de personnes déplacées. Un bouleversement climatique. » Cela évoque bien la catastrophe climatique qui nous semble nous guetter. De plus, lorsque Elon Musk et des centaines de personnalités ont signé mercredi 29 mars 2023 une tribune pour suspendre pendant six mois la recherche sur les intelligences artificielles, il est difficile de ne pas songer à ce film intitulé Intelligence Artificielle et au projet initié dans le scénario de créer pour la première fois des robots doués de sentiments.
Flash-back : Stanley Kubrick meurt en 1999 en pleine post-production d’Eyes Wide Shut. Il laisse un projet dans ses cartons, inspiré d’une nouvelle de Brian Aldiss. Il en avait parlé souvent à Steven Spielberg, le jugeant plus apte à mettre en scène cette histoire que lui-même. Spielberg récupère donc le projet et en fait un cauchemar froid et clinique, une vision futuriste glaçante où un robot doué de sentiments réclame de l’amour de la part de sa « mère », sans espoir de retour. On peut s’interroger sans fin sur la paternité du projet A.I. mais il ne fait nul doute que Spielberg s’est complètement réapproprié le sujet et qu’il est désormais difficile de démêler dans le film ce qui lui appartient en propre et ce qui revient à Kubrick.
Les cinquante premières minutes de A.I. sont tout bonnement exceptionnelles, décrivant l’éducation de David, l’enfant-Méca, – parfaitement incarné par Haley Joel Osment qui signe là sa plus grande interprétation après Sixième sens de Shyamalan,- son amour éperdu pour sa mère, sa rivalité avec Martin, l’enfant légitime réveillé de son coma, et son abandon final au milieu d’une forêt. Cette première partie s’avère très âpre et froide, assez kubrickienne, avec ce mot d’adieu sybillin de Monica Swinton, la « mère » de David, « Pardon de ne pas t’avoir expliqué le monde« , rappelant à tous les parents leur rôle protecteur à l’égard de leurs enfants et leurs défaillances fréquentes à ce sujet. Aucun parent ne prépare suffisamment ses enfants à la cruauté de ce monde, c’est ce que rappelle opportunément Monica.
Il ne faut pas oublier que A.I. arbore les atours d’un conte futuriste. Dans la deuxième partie, on ne sait plus trop si Spielberg s’adresse aux enfants avec des fétiches (Teddy le nounours qui parle, le Docteur Je-sais-tout en incarnation de synthèse tout droit sortie d’un film d’animation) ou aux adultes (Gigolo Joe, le robot d’amour, la tristesse qui se dégage de l’ensemble). Dans cette partie, une grande séquence s’impose : celle de la Foire à la chair, inspirée des jeux du cirque, où les Mécas servent de chair à canon pour divertir les humains. Cette séquence revendiquée par Spielberg rappelle étrangement les camps où les nazis disposaient de la vie et de la mort des Juifs, dans une optique de complète déshumanisation. En plein coeur d’un film qu’on aurait pu croire un retour aux films fantastiques et de science-fiction du début de sa carrière, Spielberg montre que l’heure n’est plus vraiment aux rêves et à l’illusion. La réalité est déjà là, guère enthousiasmante, l’Histoire nous rattrape, y compris dans nos plus belles fictions.
Dans la troisième partie, arrivé à New York avec Gigolo Joe et Teddy, David retrouve son véritable père, le Professeur Hobby qui l’a créé en prenant pour modèle son fils défunt. Mais il s’aperçoit qu’il a été créé à des milliers d’exemplaires, en découvrant une multitude de doubles. Il n’est donc pas le seul David sur Terre, ce qui a pour effet de le plonger dans une profonde dépression et de le conduire jusqu’au suicide. Il en réchappe et part avec Teddy explorer l’océan, ayant entraperçu lors de sa tentative de suicide la silhouette de la Fée Bleue qui est censée pouvoir le transformer en petit garçon, cf. l’histoire de Pinocchio. Il la découvre au fond de l’océan et reste médusé et figé dans son vaisseau sous-marin pendant deux mille ans…Les détracteurs de Spielberg l’ont souvent accusé d’avoir ajouté la suite de l’histoire, plus sentimentale, à partir de la découverte de la Fée bleue, alors qu’il a juré ses grands dieux que Kubrick avait spécialement conçu la fin du film et qu’il a respecté scrupuleusement sa vision.
Dans la dernière partie, David et Teddy sont sauvés par des Mécas du futur qui les ont retrouvés au fond de l’océan. L’un des Mécas (voix de Ben Kingsley) explique à David que les hommes ont définitivement disparu et qu’il ne lui est donc plus possible de revoir sa mère Monica, à moins qu’il ait gardé un échantillon physique de son corps. Teddy a miraculeusement gardé une mèche de cheveux de Monica, ce qui permet de la ressusciter, mais comme chanterait Bowie, « just for one day ». David vit avec exaltation cette journée unique avec sa mère et lorsqu’elle s’endort pour toujours, décide de la rejoindre au pays des rêves, c’est-à-dire de mourir avec elle. Cette fin sublime, assez oedipienne, montre pour la première fois que le voeu ultime de l’enfant perdu de Spielberg consiste à dormir dans le même lit que sa mère, tout au moins à la rejoindre définitivement. A.I. est donc un conte étrange, parfois visant les enfants, souvent davantage destiné aux adultes, où Spielberg franchit un palier incontestable, en s’instituant héritier naturel de Kubrick dans l’un de ses plus beaux films et en atteignant une profondeur insoupçonnée dans son dénouement, une conclusion inouïe, traitée sans la moindre provocation, avec une extrême douceur et une poésie indicible.
David Speranski
Minority Report : futur ou déjà présent?

Réalisé juste après A.I. et quelques années à peine avant La guerre des mondes, Minority Report est ainsi la 2ème incursion de Spielberg dans la SF sur une période très brève, 25 ans après Rencontres du 3ème type. Adaptant une nouvelle d’anticipation de Philip K. Dick, le réalisateur restitue avec un soin particulier l’univers de la nouvelle, ce qui explique en partie la postérité du film, dont les technologies imaginées et surtout les thématiques discutées (certes déjà présentes dans la nouvelle) restent d’une actualité presque effrayante.
Ce sont aussi la qualité et la cohérence de l’adaptation qui permettent cela, offrant une collaboration avec Tom Cruise dont la qualité (y compris de ton) continuera sur La guerre des mondes. Si le film est aussi (et, en fonction de ce qu’on cherche, surtout) un blockbuster de divertissement très (très) efficace, c’est avant tout la construction de son monde de 2054 et ses études sociopolitiques et psychologiques qui permettent au film de résonner dans le temps, que ce soit sur la boucle ultra-sécuritaire des PréCogs finissant par se mordre la queue, l’illusion de son fondateur d’une maitrise du monde qu’il n’aura jamais, ou la discussion plus philosophique de l’opposition entre déterminisme et libre arbitre. C’est la fluidité avec laquelle le film enchevêtre cela dans un film à suspense à gros budget qui enthousiasme, d’autant que la maestria technique développée par Spielberg et son équipe atteint sans doute ici un paroxysme. Au-delà du travail particulièrement marquant de Janusz Kaminski sur la photo tout en bleach bypass et en grain argentique exacerbé, un choix assez fou quand on y réfléchit pour un film hollywoodien pareil.
Mais c’est justement la brutalité de cet étau sécuritaire, tour à tour abstrait et ultra-administré, que le film met en scène : ce sentiment de maîtrise basé sur un mensonge, le péché originel transformant le système en colosse aux pieds d’argile à trop supposer que tout le monde est coupable et que ce n’est qu’une question de temps avant que la démonstration soit faite. Tout le monde ? Non, bien sûr : pas les architectes du système, forcément au-dessus de la plèbe, des gens qui ne sont rien et peuvent donc disparaître discrètement pour mieux permettre au système de profiter à ceux qui le mettent en place, et au-dessus de ceux qui maintiennent ce système, petites mains sacrifiables à l’envi une fois leur rôle effectué ou qu’ils commencent à dépasser le minuscule cadre qui leur est imparti. En cela, la course de Thomas Anderson est autant une course vers l’enquête de ce qu’il se passe qu’une quête vers l’émancipation et la quiétude.
C’est cette construction narrative qui propulse le récit et scotche le spectateur, avec une science du spectacle et du montage faisant du film une des plus grandes réussites du genre, et un des tout meilleurs films de son réalisateur.
Remy Pignatiello
Arrête-moi si tu peux : à la recherche de l’enfance perdue

Vingt-deuxième long métrage de Steven Spielberg, Arrête-moi si tu peux est une des œuvres les plus populaires du cinéaste. Réputé pour son casting trois étoiles et son incroyable scénario inspiré d’une histoire vraie mêlant action et humour, le film a rapporté plus de 352 millions de dollars au box-office mondial. Mais derrière le blockbuster hollywoodien sans âme, se cache une œuvre plus intimiste qu’il n’y paraît, une véritable plongée dans la psyché du réalisateur.
En partie basé sur l’autobiographie de Frank Abagnale Jr parue en 1980, le film retrace le parcours atypique de cet adolescent, incarné par Leonardo DiCaprio, devenu l’un des plus grands escrocs américains en se faisant passer tour à tour pour un pilote de ligne, un médecin et un avocat. En parallèle, le long métrage suit l’enquête de l’agent du FBI chargé de l’arrêter, Carl Hanratty joué par Tom Hanks.
Le générique d’Arrête-moi si tu peux – référence de la pop culture maintes fois parodiée (dans la série Les Simpsons par exemple) – introduit le jeu du chat et de la souris qui va opérer entre les deux hommes. Une relation qui n’a jamais existé dans la réalité et qui a été créée de toutes pièces par Spielberg pour traiter le sujet qui l’intéresse réellement derrière cette histoire de chasse à l’homme : la quête d’une figure paternelle.
On retrouve dans le film deux visions de la paternité qui s’opposent : d’un côté le fantasque Frank Senior (Christopher Walken), aimant mais défaillant, et de l’autre le terre-à-terre Carl, distant mais rassurant. Le film se clôt d’ailleurs sur la mort du premier et le ralliement au second. Une fois que Frank réalise qu’il a trouvé la stabilité qu’il cherchait en la personne de Carl, il décide de stopper sa fuite en avant pour exercer ses talents à ses côtés.
Au-delà du portrait d’un voleur plein d’assurance à la Arsène Lupin, Spielberg nous donne à voir celui d’un adolescent apeuré qui ne parvient pas à faire le deuil de la douce période de l’enfance. A partir d’un matériau universel, le réalisateur parvient à nous livrer un de ses récits les plus personnels regroupant toutes les thématiques qui lui sont chères : l’enfance, la famille, l’Histoire.
Bien avant The Fabelmans, Spielberg était déjà en train de nous parler de lui. Tout comme Frank, le jeune Steven a grandi dans les années 60, a été profondément marqué par le divorce de ses parents et a usé de subterfuges pour arriver à ses fins – il se serait notamment fait passer, à l’âge de 16 ans, pour un cadre afin de pénétrer dans les studios d’Universal. On retrouve dans Arrête-moi si tu peux ce qui fait l’essence du cinéma de Spielberg : un récit de l’intime – le cocon familial – au cœur d’un grand spectacle.
Emmanuelle Etienne
Le Terminal : (pas) seul au monde

Dans la série mirifique de réalisations de Spielberg du début du XXIème siècle, (peut-être sa plus grande période). six grands films enchaînés comme à la parade, Le Terminal, coincé entre Arrête-moi si tu peux et La Guerre des mondes, fait un peu office d’enfant délaissé, recevant un accueil mitigé de la part du public comme des critiques. Pourtant cette rare incursion dans la comédie, le seul précédent étant 1941, est loin d’être négligeable, ne déparant pas dans cette incroyable suite de films allant de A.I. à Munich et faisant de Spielberg probablement le plus grand cinéaste américain des années 2000. Le Terminal possède beaucoup de scènes comiques, voire burlesques, mais ne relève pas complètement de la pure comédie, car elle se teinte beaucoup de commentaire social et politique sur l’Amérique de George W. Bush qui était le président des Etats-Unis à l’époque.
En apparence, Le Terminal ressemble à une pause dans l’oeuvre de Spielberg, entre deux blockbusters avec Tom Cruise (Minority Report, La Guerre des Mondes) et un film extrêmement personnel, sorte d’autobiographie cachée (Arrête-moi si tu peux). Comme l’indique le slogan promotionnel du film, « la vie attend« . Ce film distille pourtant à chaque nouvelle vision un charme certain, ce qui contribuera sans doute à en faire un futur classique. L’histoire du film s’inspire d’un fait divers réel, survenu à un réfugié iranien, Mehran Karimi Nasseri, bloqué de 1988 à 2006 dans un terminal de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Bien que Spielberg ait acheté les droits de ce fait divers, il n’en sera jamais fait mention dans la promotion du film, le metteur en scène souhaitant exploiter la dimension métaphorique de l’histoire, plutôt que retranscrire son contexte politique de manière documentaire.
Le Terminal donne surtout l’occasion à Spielberg et Tom Hanks de réitérer leur collaboration, leur troisième après Il faut sauver le soldat Ryan et Arrête-moi si tu peux, et peut-être leur plus belle, Tom Hanks étant quasiment de toutes les séquences du début jusqu’à la fin. Spielberg ne se privait d’ailleurs pas de dire qu’il s’agissait du plus beau rôle de Tom Hanks, bien plus que ceux qui lui ont permis de remporter des Oscars (Philadelphia, Forrest Gump). Tourné quelques années après Seul au monde, Le Terminal fait écho au film de Robert Zemeckis, Tom Hanks devant apprivoiser progressivement l’art de la survie dans un milieu sinon hostile, du moins indifférent à son sort. De façon singulière, Le Terminal renvoie également à un film de Spielberg, Empire du Soleil, où le petit Jamie doit faire aussi flèche de tout bois pour pouvoir survivre.
L’immense décor reconstituant un terminal d’aéroport évoque Playtime de Tati. Envahie par les marques, symboles de la société de consommation, cette gigantesque toile de fond, sorte d’Amérique en modèle réduit, n’apparaît guère comme une terre d’accueil favorable aux immigrants. Le message est clair : l’Amérique bushienne n’accueille pas à bras ouverts les immigrants. Ceux avec qui l’immigrant Viktor Navorski va sympathiser travaillent donc aux portes de New York, demeurant ainsi à la limite de l’intégration, tolérés plus qu’acceptés ; Dolores Torres, une Afro-américaine, employée au service de l’immigration (Zoe Saldana, quelques années avant le triomphe d’Avatar), Enrique (Diego Luna), le transporteur mexicain, amoureux platonique de l’employée ; Gupta (excellent Kumar Pallana, acteur fétiche de Wes Anderson, qui tient peut-être ici le rôle de sa vie), un vieil agent d’entretien, venu d’Inde suite à un homicide. A travers cette réunion, Spielberg expose ainsi un rêve utopique de société multiculturelle que l’Amérique a rejeté aux frontières de New York. Même Viktor Navorski, quand il finira par atteindre son but, ne restera pas aux Etats-Unis mais repartira presque aussitôt. L’Amérique n’est plus une terre d’accueil, semble signifier Spielberg mais un espace transitoire de passage.
La romance que Victor va nouer avec Amelia Warren, une hôtesse de l’air dépressive, déçue par une relation insatisfaisante avec un homme marié, démontrera la même chose. Elle ne représentera que du provisoire, la promesse d’un amour impossible qu’il vaut mieux ne pas concrétiser pour pouvoir se contenter des illusions qu’il a produites. Catherine Zeta-Jones, en femme de trente-cinq ans perdue entre sa carrière d’hôtesse de l’air, un rythme exténuant de voyages incessants et une vie sentimentale qui paraît s’auto-détruire sous ses yeux, tient assurément dans Le Terminal son plus beau rôle celui d’une illusion amoureuse terriblement séduisante à qui on ne peut se fier.
Dans la séquence d’introduction, des touristes se présentant aux guichets de l’aéroport sont filmés exactement de la même manière que les Juifs de La Liste de Schindler, par une suite de plans abrupts, montés cut de manière sèche, histoire de montrer que l’Amérique photographiée sous des teintes froides (bleues ou vertes) n’est guère hospitalière. Viktor Navorski sera même qualifié d »inacceptable« , ce qui renvoie aux heures les plus sombres de notre Histoire. Si Le Terminal est une grande comédie qu’on revoit toujours avec un plaisir non dissimulé, c’est parce qu’elle s’appuie, comme les films de Chaplin, sur un sens du détail que les plus démunis comprendront sans peine (l’argent que Viktor gagne pièce par pièce en comparaison de la maigre pitance que ces revenus lui rapportent) et sur un contexte très sombre, celui d’une Amérique qui ferme ses portes.
David Speranski
La Guerre des Mondes : festival d’apocalypses

Avant tout, permettez-moi de vous adresser tous mes vœux de bonheur pour 2023. J’espère que vous ne m’en voudrez pas trop si je cause des deux films concomitamment, ils se ressemblent un peu. J’aime bien, mais la personne chère à mon cœur, qui s’était déjà distinguée par une généreuse salve de persiflages lors du visionnage d’A.I., ne semble pas, à en croire ceux entendus ici, professer un goût immodéré pour le cinoche de Spielberg. Le pire, c’est qu’elle a raison, ah Hollywood et ses personnages chaussés de gros sabots, mauvais père féru de mécanique, petite fille crispante nourrie au houmous — en ce qui me concerne, ça ne me dérange pas, plutôt que de sabots je préfère parler d’archétypes. Elle concède cependant un surcroît d’inclination pour le virtuose Minority Report, dont les constantes ruptures de ton — de la noirceur dystopique au burlesque, en passant par le drame intime du deuil de l’enfant — sont une des composantes de la maestria.
Votre humble serviteur quant à lui préfère l’autre, plus uniment sombre — peut-être pour ces moments que je trouve très beaux, comme la première succession d’images, de l’échelle de la bactérie à celle de la planète, qui font un trône pour la voix de Morgan Freeman (il récite le début du bouquin de Wells, un peu réécrit. C’est un texte que je connais par cœur, ’’Yet across the gulf of space, intellects vast and cool and unsympathetic regarded our planet with envious eyes, and slowly and surely, drew their plans against us’’). Il y a aussi l’incroyable séquence où le premier tripode sort de terre, celle du ferry qui chavire, celle de la sempiternelle colline spielbergienne derrière laquelle c’est l’horreur, il y a la rivière charriant des cadavres et le train fou en flammes, bref c’est un festival d’apocalypses, jusqu’à la fin qui refait celle de La Prisonnière du désert — le héros à défauts, mauvais père, voleur de voiture, assassin, ne peut pénétrer dans la maison du bonheur.
Puisque nous sommes au rayon réminiscences de classiques, revenons à Minority Report, dont la fin fait, elle, penser à celle de L’Invraisemblable Vérité, avec le méchant qui se trahit en énonçant étourdiment ce qu’il n’était pas censé savoir. De même, une des plus belles scènes — même si à la re-vision, j’ai trouvé ça moins impressionnant que le souvenir que j’en avais —, celle où Cruise rejoue Chaplin avalé par la chaîne de montage des Temps modernes. Il me semble également avoir entraperçu des images de House of Bamboo, excellent polar de Fuller qui se passe à Tokyo, diffusées dans le cabinet de l’ophtalmo clandestin. Quittons les rives du classicisme pour conclure, deux mots sur ce qui fait la spécificité du cinoche hollywoodien late nineties/early noughties, à savoir le scénario alambiqué. Primo, ça génère des incohérences — comment se fait-il que l’empreinte oculaire du prévenu continue d’ouvrir sans problème les portes sécurisées, appelez-moi le directeur. Secundo, ça nécessite certaines stations explicatives pendant lesquelles on s’ennuie un peu, comme la rencontre avec la sorcière — je veux dire, la fondatrice du programme ’’pré-crime’’ —, l’analyse du faux écho du pré-crime bidon par l’infortuné Colin Farrell, ou l’épilogue vengeur avec cette autre figure du mauvais père qu’incarne Max von Sydow
Poulet Pou
Munich : un monde désolé

Après le dénouement tragique de la prise en otage des athlètes israéliens par Septembre noir aux Jeux olympiques de Munich de 1972, la Première ministre Golda Meir ordonne le déclenchement de l’opération ’’Colère de Dieu’’ : la traque et l’exécution de plusieurs activistes palestiniens.
Munich met en scène les actions de l’équipe du Mossad et de leur chef Avner Kaufman (interprété par Eric Bana). Le film s’attache à en rendre les membres sympathiques – leur caractérisation est digne des clichés des buddy movies – pour mieux faire ressortir le sordide absolu de leur mission. La ’’scène de trop’’, courante chez Spielberg, survient assez tôt et fonctionne comme un révélateur : les agents du Mossad ont piégé le téléphone d’une de leurs cibles, mais c’est la fille de celle-ci qui décroche. Va-t-il y avoir une victime collatérale ? Le film se joue très cruellement du spectateur avec ce suspense atroce ; évidemment les héros parviennent in extremis à sauver l’enfant – mais ce répit moral n’est qu’un leurre.
Au début plein d’allant et confiant quant à la légitimité de sa tâche, Avner Kaufman, au fur et à mesure que les cadavres s’entassent, finit par sombrer dans la dépression et la paranoïa (le film cite la célèbre scène de The Conversation de Coppola où le héros démonte son appartement à la recherche de micros).
Très tôt – dès les premières scènes, on s’attarde longuement sur divers écrans de télévision accaparés par les preneurs d’otages – on se rend compte qu’Israël a perdu la guerre des images : à chaque meurtre minutieusement préparé en secret répond un nouvel attentat palestinien largement médiatisé. Il y a d’ailleurs un dialogue fructueux entre les images des journaux télévisés et les images mentales de la prise d’otages, faux souvenirs que se fabrique le héros tout au long du film.
Comme souvent avec Spielberg, j’ai ressenti de l’écœurement lors du visionnage. C’est dû à l’aspect volontiers caricatural des personnages, à la musique pompeuse de John Williams, à des effets de mise en scène qui semblent à première vue extrêmement grossiers (je pense en particulier aux images sanglantes de la prise d’otages alors que le héros tente de faire l’amour avec son épouse). Mais comme souvent avec Spielberg, le film se bonifie et se magnifie dans le souvenir. Ce qui était lourd devient puissant, et toute la subtilité de Munich, qui subvertit les conventions du film d’espionnage hollywoodien, se révèle. Il reste en mémoire la description d’un monde désolé, où la violence finit par séparer ceux-là mêmes qui partageaient un idéal. Le film A.I. m’a fait exactement le même effet : la scène finale m’avait sur le moment semblé d’une mièvrerie totale, mais je la considère maintenant comme une des plus belles choses que j’ai vues de ma vie au cinéma.
Poulet Pou
Le Pont des Espions : guerre froide

Après Munich qui a beaucoup divisé à la fois les sionistes, les antisionistes et tous les autres, Spielberg s’est accordé une longue pause de trois ans et termine cette décennie 2000, peut-être la plus belle de son cinéma, par un film divertissant et récréatif, comme s’il avait déjà tout dit de 2001 à 2005. Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal n’a rien apporté à sa gloire de metteur en scène, même si le succès public a encore une fois été au rendez-vous. Il est troublant de constater que ses meilleurs films dans cette décennie ont été tournés au climax du double mandat de George W. Bush. Etrangement, en 2009, depuis l’investiture de Barack Obama qu’il a finalement soutenu après Hilary Clinton, Spielberg se tait, n’ayant rien à ajouter sur le plan politique ni cinématographique. De 2008 (où l’on pouvait déjà pressentir, prédire et ressentir l’Obamamania) à 2013, Spielberg va traverser une période de creux artistique, comparable à celles qu’il a déjà vécues de 1989 à 1991 (de La Dernière croisade à Hook) ou de 1997 à 1998 (du Monde Perdu à Il faut sauver le soldat Ryan). Rebelote donc de 2008 à 2013, excepté que la période de brouillard artistique va durer deux fois plus longtemps. Entendons-nous bien, la plupart de ces films ne représentent pas des échecs publics ou critiques (on avouera même des plaisirs coupables éprouvés devant La Dernière Croisade ou Le Monde perdu) mais ne se trouvent pas exactement au même niveau de réussite et de qualité que les autres films se trouvant dans ce dossier. Naviguant à vue entre des films trop « enfantins » (Tintin, Indiana Jones 4) et d’autres trop académiques (Lincoln), Spielberg semble avoir bien du mal à trouver ses marques depuis l’élection d’Obama.
Les fans de Spielberg trépignent et commencent à perdre confiance, surtout après ce parangon d’académisme boursouflé, paraissant tourné sur mesure pour l’Académie des Oscars, Lincoln. Paradoxalement, malgré un record de nominations, Spielberg ne recevra aucun Oscar pour ce film, hormis l’Oscar du meilleur acteur dévolu à la prestation figée de Daniel Day-Lewis, tout droit sorti du Musée Grévin. Il repart donc presque bredouille comme il l’a fait totalement pour La Couleur pourpre ou Empire du Soleil. Là où John Ford continue à éblouir les cinéphiles avec son magistral Young Mister Lincoln, le Lincoln de Spielberg semble déjà prendre la poussière dont il a été douloureusement exhumé. Mais cet échec artistique représente en fait un mal pour un bien, et oblige Spielberg à se recentrer sur ses véritables plaisirs de cinéma et de mise en scène.
Après le camouflet reçu aux Oscars, Spielberg préside presque par compensation le 66ème Festival de Cannes (exactement son âge au moment du Festival) et se confronte donc à la vitalité du cinéma mondial. Avec son jury, il décerne à l’unanimité la Palme d’or à La Vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche, accompagnée d’une double Palme pour ses interprètes, Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux, décision exceptionnelle sans précédent ni suite. Consécutivement à sa présidence cannoise, Spielberg est quelque peu guetté au tournant. Il abandonne successivement les projets de Robopocalypse, film de science-fiction sur la révolte des robots (trop coûteux) et d’American Sniper (trop polémique) qu’il passera à son collègue Clint Eastwood. Que va-t-il donc pouvoir faire?
Or, en mars 2014, Vladimir Poutine annexe la Crimée à la fédération de Russie, violant le droit international et suscitant un immense tollé dans le monde occidental, Ce faisant, il réactive la Guerre froide et les menaces d’attaques nucléaires dans un contexte d’équilibre de la terreur. C’était l’inspiration dont Spielberg avait besoin pour s’intéresser de nouveau à la Guerre froide qui l’avait beaucoup perturbé lorsqu’il était enfant dans les années 1950, au point de croire à une fin du monde très proche. Si Lincoln représentait déjà un début de tournant politique dans son oeuvre, cet intérêt politique est confirmé de belle manière par Le Pont des Espions, où l’on retrouve enfin le Spielberg que l’on aime, malicieux et humaniste, ménageant de formidables séquences de suspense (la filature sous la pluie, l’échange des espions sur le pont) et de superbes moments de direction d’acteurs (les dialogues entre James Donovan, avocat d’assurances catapulté dans un roman d’espionnage, et Rudolf Abel, l’espion soviétique interprété très finement par l’excellent Mark Rylance). Pour sa quatrième collaboration avec Spielberg (sa plus remarquable avec Le Terminal), Tom Hanks consolide sa stature d’héritier de James Stewart en défenseur des valeurs démocratiques, avocat sachant négocier et y voir clair dans le jeu trouble des faux-semblants. Travaillant pour la première fois avec Spielberg, Mark Rylance, en espion matois, avec sa fameuse réplique ironique » ça aiderait?« . compose un personnage mémorable, enrichi par la participation des frères Coen au scénario et aux dialogues, en économisant de façon remarquable ses effets, ce qui lui permettra de décrocher en 2016 l’Oscar du meilleur second rôle masculin.
En le comparant avec Lincoln, Le Pont des Espions permet de saisir la différence entre académisme et classicisme. En usant d’une mise en scène précise, discrète mais redoutablement efficace, Spielberg se coule dans le moule d’un classicisme brillant, un peu désuet et anachronique, mais extrêmement plaisant. On peut voir et revoir Le Pont des Espions et y trouver toujours le même plaisir renouvelé. C’est peut-être même le premier film où l’on peut percevoir avec clarté un des grands projets implicites de Spielberg, c’est-à-dire retracer une histoire politique des Etats-Unis lors des deux siècles derniers, avec Amistad, Lincoln, La Couleur Pourpre, Il faut sauver le soldat Ryan, Le Pont des Espions. Pentagon Papers continuera quelques années plus tard cette saga historique. On peut même rajouter que Spielberg étend son histoire au monde entier, horizontalement sur tous les continents (Empire du Soleil, La Liste de Schindler, Cheval de Guerre) et verticalement, servant de trait d’union incongru et exceptionnel entre les dinosaures (Jurassic Park, Le Monde perdu) et les extra-terrestres (Rencontres du troisième type, E.T., La Guerre des mondes).
Au premier abord, Le Pont des espions n’est sans doute pas le film le plus impressionnant de Steven Spielberg, s’épanouissant dans un classicisme ultra-balisé mais distillant un plaisir certain. Cependant il possède l’immense mérite d’avoir remis le Maître en selle et de l’avoir relancé pour la cinquième grande période de son parcours artistique.
David Speranski
Pentagon Papers : une femme envers et contre tout

Au cours de l’année 2017, la post-production de Ready Player One prend un temps infini en raison du grand nombre d’effets spéciaux et de la performance capture. Donald Trump, candidat républicain, vient d’être élu et investi Président des Etats-Unis, et fait peser des menaces importantes sur la démocratie, la liberté d’opinion et de la presse. Il n’en faut pas davantage pour réveiller Spielberg qui avait soutenu comme à l’accoutumée le camp démocrate en la personne d’Hilary Clinton et pour réactiver la veine politique de son oeuvre.
Conçu, écrit et tourné au pas de course, Pentagon Papers constitue donc la réaction de Spielberg à l’élection-surprise de Donald Trump. Spielberg qui avait commencé à se réfugier dans ses fictions fantastiques et féériques habituelles (Le Bon Gros Géant, Ready Player One), se voit obligé de reprendre sa casquette de cinéaste engagé et donc de sortir le troisième volet de sa trilogie politique : après le lénifiant Lincoln, écho à son admiration pour Obama, puis le classique mais efficace Pont des Espions, voici donc le revigorant Pentagon Papers, sur la publication d’une étude préparée par le département de la Défense, soit plus de sept mille pages top secret dévoilant l’implication politique et militaire des Etats-Unis dans la guerre du Viet-Nam, par deux journaux, le New York Times et le Washington Post, l’histoire étant racontée du point de vue de la rédaction du Washington Post (The Post étant le titre original du film).
Spielberg qui était sans doute le moins politisé des enfants terribles (Movie Brats) du Nouvel Hollywood, cf. son indifférence presque totale au conflit vietnamien dans les années 60 et 70, est paradoxalement devenu au fil du temps le cinéaste le plus politique du groupe. Il commence ainsi Pentagon Papers par quatre minutes de guerre du Viet-Nam, au point que certains spectateurs pourront légitimement croire s’être trompés de salle.
Si Le Pont des Espions indiquait un net regain de forme artistique chez Spielberg, avec Pentagon Papers, pas de doute, Spielberg est de retour au plus haut niveau : mise en scène inspirée, mouvements de caméra vifs, direction d’acteurs au cordeau (Bob Odenkirk, Carrie Coon, Matthew Rhys). Spielberg a mis en route ce projet extrêmement vite mais cette précipitation dans l’urgence n’a étrangement pas nui à sa qualité, bien au contraire. On ressent presque physiquement la circulation des informations, leurs conséquences sur l’opinion, et le travail frénétique des journalistes, se privant de déjeuner ou de loisirs pour rester à l’affût du moindre scoop. Spielberg se paie même le luxe d’inventer des séquences typiquement spielbergiennes, comme celle du stagiaire devant infiltrer une rédaction concurrente, ou de réussir à rendre crédible un véritable suspense qui ne devrait pourtant pas occasionner de surprise aux vrais connaisseurs de l’Histoire. Tom Hanks, pour sa cinquième et dernière collaboration à ce jour avec son metteur en scène favori, compose cette fois-ci un personnage à la John Wayne, Benjamin Bradlee, rédacteur en chef du Post, sorte de cow-boy égaré dans une rédaction, après s’être inspiré de James Stewart pour son rôle dans Le Pont des Espions.
Néanmoins l’interprétation la plus remarquable du film n’est point celle de Tom Hanks, contrairement à ce que l’on aurait pu croire. Avec un sens du timing exceptionnel auquel on reconnaît parfois les grands metteurs en scène, Spielberg rend hommage quelques mois après #MeToo à Katharine Graham, grande patronne de presse, directrice du Washington Post. Katharine Graham n’était pourtant pas faite a priori pour devenir directrice de journal. Après le suicide de son mari Phil Graham qui dirigeait le Washington Post alors qu’elle s’est occupée de l’éducation de leurs enfants, elle lui a succédé à la tête du journal. Manquant de confiance et d’expérience, elle se sentait méprisée et sous-estimée par ses collaborateurs. Or c’est elle qui, par une résolution inébranlable, a courageusement décidé, au risque de finir ses jours en prison, de publier les Pentagon Papers. Meryl Streep qui n’avait jamais collaboré avec Spielberg, hormis la voix de la Fée Bleue dans A.I, donne au personnage toute sa dimension d’humilité non feinte et d’intelligence intuitive exceptionnelle. Filmée selon la situation de domination ou de soumission en plongée ou en contre-plongée, Meryl Streep incarne pleinement cette femme forte, malgré ses hésitations et failles, isolée et opprimée dans un monde d’hommes. Sur l’ensemble de sa filmographie, Spielberg est assez peu réputé pour sa direction d’actrices : il a pourtant offert de très beaux personnages à des actrices qui s’en sont brillamment emparé : Goldie Hawn (Sugarland Express), Whoopi Goldberg (La Couleur Pourpre), Meryl Streep (Pentagon Papers) et Michelle Williams (The Fabelmans). Le personnage de Katharine Graham est certainement l’expression la plus évidente d’un féminisme discret, non militant, dû au fait que Spielberg a été élevé dans un environnement presque exclusivement féminin (sa mère et ses trois soeurs).
Pentagon Papers représente donc un hymne extrêmement convaincant à la liberté de la presse. La fourmilière de journalistes en ébullition dépouillant les Pentagon Papers demeure sans doute une image inoubliable et un exemple iconique pour tous les journalistes dignes de ce nom. Lorsque Spielberg filme à la fin du film les rotatives d’impression avec une gourmandise non dissimulée, il se dégage de Pentagon Papers un ineffable plaisir physique, voire presque l’odeur fraîche du papier journal diffusant les bonnes ou mauvaises nouvelles. L’ombre de Nixon, filmée de dos, plane sur le long-métrage, (Spielberg a utilisé la vraie voix de Nixon dans sa pénultième séquence) en reflet annonciateur d’un Trump qui rôde à l’époque dans les couloirs de la Maison-Blanche. Spielberg affiche même la suprême élégance d’interrompre son film juste avant la découverte du scandale du Watergate, raccordant avec un classique du cinéma d’investigation, Les Hommes du Président de Alan J. Pakula, et définissant modestement Pentagon Papers comme une préquelle indispensable dans le cadre de l’histoire du cinéma politique des Etats-Unis.
David Speranski
Ready Player One : Pop Culture

On avait laissé Steven Spielberg deux mois auparavant sur Pentagon Papers qui exprimait un net regain de forme de sa part. Néanmoins le sujet beaucoup trop classique de journalisme politique ligotait un peu l’expression de son style. On attendait avec Ready Player One la confirmation de cette inspiration revivifiée. Le Boss (un peu comme Springsteen dans le rock) est réellement de retour avec ce film de science-fiction qui s’avère être sans doute le seul classique instantané de ce genre cette année, voire de cette décennie. Il a enfin fallu ce film pour retrouver Spielberg à son plus haut niveau d’inventivité narrative et de prouesse technologique, alliance rare qu’il est le seul à pouvoir offrir ainsi au grand public.
Ce n’était pourtant pas partie gagnée au vu de ses derniers films. Lincoln, Le Bon Gros Géant, etc. étaient des films mineurs qu’on allait voir en étant un peu obligés, pour ne pas manquer un chapitre de son œuvre. Il faut remonter à La Guerre des Mondes (2005) pour se souvenir d’un Spielberg véritablement enthousiasmant. Néanmoins il fallait compter sur la schizophrénie assumée du bonhomme: il s’attache souvent à produire alternativement un film pour l’Académie des Oscars (La Couleur Pourpre, L’Empire du Soleil, La Liste de Schindler, Amistad, Il faut sauver le soldat Ryan, Munich, etc. ) et un film pour le fun, le divertissement, pour l’adolescent qu’il n’a jamais cessé d’être (Les Dents de la mer, Rencontres du troisième type, Les Aventuriers de l’arche perdue, E.T., Jurassic Park, Minority Report, Arrête-moi si tu peux, etc.). Souvent ses films les plus sérieux ne sont pas forcément ses films les plus personnels et inversement.
Ready Player One est ainsi une fiction dystopique où le monde va particulièrement mal, sur les plans social, politique et écologique : les gens vivent pour leur plus grande majorité dans des bidonvilles et se réfugient par mode compensatoire dans un univers de fiction partagée, l’OASIS, créée par un mystérieux démiurge, James Halliday, qui vient de disparaître. Ce dernier a laissé une énigme disséminée dans son monde virtuel. Celui qui trouvera les trois clés de cette énigme deviendra le propriétaire de l’OASIS. Face à Nolan Sorrento, propriétaire de l’OAI, multinationale dominant une partie du monde économique, quelques rebelles, Wade Watts, un jeune homme à peine sorti de l’adolescence, Samantha et quelques autres, cherchent à résoudre l’énigme avant lui.
Cette intrigue, inspirée par le roman culte d’Ernest Cline, s’avère être le prétexte pour Spielberg, tel un Janus à deux visages, pour regarder à la fois le passé et l’avenir. Du côté du passé, comme Halliday fait des références incessantes à la culture de sa jeunesse, les années 80 sont à l’honneur. Ready Player One ressemble à une synthèse ahurissante de la pop culture issue de cette décennie: la musique (Van Halen, New Order, Duran Duran, Tears for fears, etc.), la littérature (Le Seigneur des anneaux, les mangas), le cinéma (Alien, Shining, Retour vers le futur, via le Cube Zemeckis et la musique pour une fois laissée à Alan Silvestri, en lieu et place de John Williams). Du côté de l’avenir, Spielberg explore le terrain des identités virtuelles et des jeux vidéo en VR. Chaque personnage ou presque possède ainsi un double virtuel, plus beau, plus élégant, plus fort, Parzival pour Wade, Art3miz pour Samantha, etc. Parfois les âges et les sexes ne correspondent pas forcément mais tout est permis dans l’enclave de l’univers fictionnel de l’OASIS. Tout n’est qu’illusion et l’OASIS est bien entendu une métaphore sublime du cinéma qui « substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs « , comme le disait André Bazin ou plutôt Michel Mourlet.
De nombreux réalisateurs pressentis (Christopher Nolan, Matthew Vaughn, Peter Jackson, Edgar Wright, Robert Zemeckis) ont tous échoué à mettre en scène ce projet. La plupart sont d’ailleurs cités dans le film, nommément (Nolan Sorrento, Zemeckis) ou par l’image (King Kong de Peter Jackson). Cependant, seul Steven Spielberg pouvait réussir ce cocktail d’humour et de technologie de haute volée. Seul Spielberg, hormis peut-être James Cameron, pouvait réussir à montrer aussi bien la séparation et l’alternance de deux mondes, le virtuel et le réel, montrer le premier en motion captures, en faisant des dizaines de clins d’œil à la culture geek et le second, sombre et désespéré, avec la photographie typique du cinéma des années 80. Seul Spielberg pouvait aussi bien relier les deux, en intégrant des personnage de VR dans le réel ou inversement, sans que le public ne s’y perde un seul instant. Seul Spielberg pouvait enfin se montrer aussi virtuose dans l’enchaînement et la fluidité des mouvements de caméra, passant de l’un à l’autre, sans discontinuer. La caméra flotte dans la virtualité, tout comme les personnages, comme dans ce numéro hallucinant de danse de Parzival et d’Art3mis sur Saturday Night Fever des Bee Gees.
Tout comme sa caméra, Steven Spielberg n’a plus de limites et peut même se permettre de rendre hommage avec humour à l’un de ses maîtres et amis, Stanley Kubrick. Pourtant dans cet univers dépourvu de frontières, hormis celles de l’imagination, Spielberg n’oublie pas en définitive de renvoyer vers le réel, l’ultime limite car « la réalité a pour principale qualité d’être réelle » . A travers son personnage, qui est d’ailleurs son portrait craché à l’adolescence, Spielberg souhaite nous dire que, bien maîtrisée, la fiction n’isole pas mais permet bien au contraire de s’épanouir, de connaître l’amour et l’amitié. En tant que Rosebud du film, c’est sans doute l’une des plus belles leçons de confiance en son moyen d’expression qu’un cinéaste pouvait nous donner.
David Speranski
West Side Story : version diversité

Tourné du 10 juin au 28 septembre 2019, West Side Story de Steven Spielberg est sans doute l’un des films les plus attendus de la planète cinéma depuis quelques années car il fut mis sous carafe pendant plus de deux ans, en raison de la pandémie de Covid-19. Il devait ainsi déjà sortir en décembre 2020 mais sa sortie fut reportée jusqu’à l’année suivante. L’attente est donc immense car le défi se révèle assez incroyable pour l’un des metteurs en scène les plus brillants de notre époque. Comment donner de l’intérêt et une certaine actualité au remake d’un classique de la comédie musicale qui fait partie des films préférés de nombre de spectateurs et cinéphiles? Steven Spielberg s’en sort avec les honneurs en proposant une version de West Side Story sur le mode de la diversité, bénéficiant de tous les progrès technologiques, dans le tournage et le montage des séquences, même s’il atteint rarement -mais parfois -le niveau de son modèle.
A New York, en 1957, deux gangs de rue rivaux, les Jets (Américains d’origine polonaise, irlandaise et italienne), avec Riff à leur tête, et les Sharks (immigrés d’origine portoricaine), menés par Bernardo, font la loi dans le quartier West. Ils se provoquent et s’affrontent à l’occasion. Tony, ex-chef des Jets qui a maintenant pris ses distances avec le gang, et ami de Riff, et Maria, la sœur de Bernardo, le chef des Sharks, tombent amoureux, mais le couple, en raison de la situation tendue entre les deux clans, doit se résoudre à constater que leur amour est impossible.
Steven Spielberg le précise à de nombreuses reprises : sa version de West Side Story ne constitue pas un remake du film de Robert Wise et Jerome Robbins, sorti en 1961, mais une nouvelle adaptation du « musical » de Broadway qui a connu le succès à la fin des années cinquante, comme s’il voulait se prémunir de toute comparaison possible avec le film estampillé chef-d’oeuvre de Robbins et Wise. Or, il est bien trop intelligent pour ne pas le savoir : une infime minorité de gens sont encore vivants pour avoir vu cette production théâtrale alors que chacun peut se reporter à la vidéo du West Side Story de 1961. Il se lance donc un défi quasiment insurmontable, refaire un chef-d’oeuvre, en réaliser une version différente, afin de lui donner une résonance accordée à notre époque.
Comment définir un chef-d’oeuvre? Une oeuvre dont tous les éléments, aussi différents soient-ils (scénario, réalisation, interprétation, direction artistique, photographie, musique, montage), fusionnent harmonieusement pour livrer un film unique, visité par la grâce. West Side Story de Wise et Robbins, combine ainsi de nombreux éléments hétérogènes qui se trouvent tous, ô miracle, au summum de la perfection : une interprétation bouleversante (Natalie Wood au pic de son pouvoir d’émotion, George Chakiris et Rita Moreno pleins d’allant et d’élégance), un livret joliment ouvragé d’Arthur Daniels inspiré du shakespearien Roméo et Juliette, des paroles ciselées par le regretté Stephen Sondheim, récemment disparu, une musique inoubliable de Leonard Bernstein, alignant les perles, une chorégraphie moderne et innovante de Jerome Robbins, enfin une mise en scène ample et efficace de Robert Wise.
Le projet de Steven Spielberg est donc à la fois extrêmement intime (le film est dédié à son père, avec qui il a sans doute partagé nombre de visionnages du film de Robbins et Wise) et résolument moderne, rendre West Side Story actuel, en en proposant une version à la hauteur des enjeux de notre temps. En ce qui concerne l’actualité du film, la réécriture de West Side Story par le scénariste Tony Kushner (Munich, Lincoln), donne en effet une consistance documentaire à l’opposition entre les Jets et les Sharks et une résonance assez profonde aux thèmes de l’intégration, du racisme et de l’opposition entre les communautés, consistance et résonance bien plus marquées sur le terrain sociétal que l’oeuvre de Robbins et Wise. Sur ces thèmes, on ne peut guère soupçonner Steven Spielberg d’opportunisme, lui qui a déjà plus de trente ans auparavant filmé La Couleur pourpre. Les Jets sont ici ouvertement racistes, alors que cela apparaissait de manière bien plus édulcorée dans la version de 1961, trouvant un écho très moderne dans certains des supporters trumpistes. De l’autre côté, les Sharks s’expriment très souvent en espagnol, Spielberg intégrant tout simplement ces bribes de dialogue dans le flux du film. Allant dans le même sens que cette actualisation sociétale, la distribution a fait l’objet de principes stricts : choisir des interprètes jeunes et appartenant à la communauté spécifiée dans le film, ce qui n’était pas forcément le cas dans la version Wise-Robbins. Idem pour l’exigence que les comédiens soient aussi des chanteurs et danseurs accomplis (Natalie Wood était doublée par Marti Nixon dans la version de 1961). On peut même souligner le fait d’avoir engagé un interprète trans pour le rôle de Anybodys, le garçon manqué qui tient un rôle-clé dans l’intrigue. Par conséquent, les intentions étaient plus que louables mais retrouver ainsi l’alchimie de la distribution originelle relevait d’un défi aussi impossible que l’amour qui lie María à Tony. La distribution du West Side Story originel en constitue l’un des grands points forts : comment imaginer égaler la performance très émouvante d’une Natalie Wood au summum de son art? Ou encore l’élégance et la grâce de George Chakiris et Rita Moreno, tous les deux oscarisés pour leurs rôles respectifs ; sans même parler des noms déjà évoqués, Richard Beymer (Tony) et Russ Tamblyn (Riff) étaient également excellents dans leurs personnages et sont ensuite réapparus dans Twin Peaks de David Lynch, qu’on suppose sans trop de mal être un des grands fans de cette comédie musicale.
C’est bien là où le bât blesse, dans la distribution. En dépit d’efforts méritoires, Ansel Elgort (Baby Driver) et la débutante Rachel Zegler forment un couple relativement anodin, comparé au duo tragique Natalie Wood-Richard Beymer ; David Alvarez propose une version intello et engagée de Bernardo, à mille lieues des entrechats magiques de George Chakiris. Seule la moitié de la distribution principale s’avère plutôt réussie : Ariana DeBose, extrêmement douée, parvient presque à faire oublier Rita Moreno en Anita ; Josh Andrès Rivera se révèle assez émouvant dans le rôle de Chino, l’amoureux éconduit de María. La plus grande innovation de la distribution consiste en fait à avoir transformé le rôle de Doc en celui de sa veuve Valentina et surtout à confier ce rôle à la revenante Rita Moreno, l’interprète originelle d’Anita. Dans ce qui est peut-être le plus beau moment du film, elle se voit attribuer le morceau culte Somewhere, l’occasion de grands frissons garantis, son interprétation jetant un pont à travers le temps entre le West Side Story de 1961 et celui de Steven Spielberg.
Par conséquent, West Side Story version Spielberg ne mérite guère d’être vilipendé. Le coeur du film, soit le flush royal de cinq chansons cultes, María, America, Tonight, I feel pretty, Somewhere, met en valeur des versions cinématographiques qui n’ont guère à rougir face aux originales (surtout America et Tonight bénéficiant d’une caméra plus mobile et d’effets de montage originaux). Steven Spielberg a fait preuve d’efforts extrêmement louables dans l’actualisation des thèmes et la mise en avant de la diversité. S’il ne s’approche que rarement de son modèle plus ou moins avoué, en raison d’une distribution inégale, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Mais contrairement au facteur, la grâce ne sonne pas deux fois au même endroit.
David Speranski
The Fabelmans : l’Enfance de l’art

Le cinéma relève très souvent de l’art du souvenir. Se souvenir des belles choses, du vert paradis de son enfance, des épiphanies de son passé, pour les fixer définitivement sur pellicule ou désormais en numérique, recréant ainsi des images ressuscitées afin de les rendre inaltérables, en les partageant avec tous. Pour un écrivain comme pour un cinéaste, le processus autobiographique est souvent gratifiant car il permet au lecteur/spectateur de s’identifier à l’artiste, en ayant traversé souvent les mêmes épreuves, et à l’auteur de livrer fréquemment l’une de ses oeuvres les plus personnelles et réussies. Depuis une avant-première mondiale triomphale au Festival de Toronto le 10 septembre 2022, d’où il est reparti avec le Prix du Public, Steven Spielberg était un peu attendu en France au tournant de son oeuvre la plus autobiographique. Il a choisi le Festival Lumière pour offrir l’exclusivité européenne de The Fabelmans et révéler ainsi son oeuvre a priori la plus personnelle le 18 octobre. A l’orée du possible crépuscule d’une carrière qui fut longue et passionnante et n’est pas encore près de s’achever, Spielberg a décidé de tomber le masque et de révéler le traumatisme profond à l’origine de sa vocation de cinéaste : la séparation de ses parents. Certes tous les enfants de divorcés ne deviennent pas, loin s’en faut, des virtuoses de la caméra. Mais The Fabelmans, en revenant sur le passé et l’enfance de Spielberg, parvient à faire comprendre à quel point chez Spielberg les deux phénomènes sont liés : pas de cinéma authentique sans un douloureux apprentissage de la vérité.
Après la Seconde Guerre mondiale, du début des années cinquante à la clôture des années soixante, Sammy Fabelman grandit paisiblement dans l’Arizona. Alors que le couple de ses parents se délite imperceptiblement, Sammy se prend d’une passion incommensurable et illimitée pour le cinéma, pressentant en lui les germes d’une vocation précoce.
En littérature, les ouvrages autobiographiques sont légion ; c’est presque autant le cas au cinéma. Pour ne citer que les plus remarquables et célèbres films autobiographiques, il faudrait mentionner Les Quatre cent coups de François Truffaut (cinéaste admiré par Spielberg), Au revoir les enfants de Louis Malle, Le Miroir d’Andrei Tarkovski, Amarcord de Federico Fellini, Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman, ou le moins connu Hope and Glory de John Boorman. De grands cinéastes reviennent ainsi sur leur passé, souvent leur enfance, et donnent à leurs admirateurs des clés précieuses pour comprendre et interpréter leur oeuvre. Cette tendance autobiographique s’est accrue avec le confinement qui a signifié pour beaucoup de cinéastes un repli sur eux-mêmes, une introspection forcée qui les a obligés assez souvent à interroger les origines de leur désir de création. Cette tendance récente a été inaugurée, voire précédée par Roma d’Alfonso Cuarón. Lors de la sortie de pandémie, nous voyons se succéder La Main de Dieu de Paolo Sorrentino, Belfast de Kenneth Branagh, Armageddon Time de James Gray et donc The Fabelmans de Steven Spielberg. Tous ces films ont pour point commun de revenir sur le passé (souvent l’enfance, dans quatre films sur cinq) d’un cinéaste, nous permettant d’observer ce qui a pu le constituer en tant qu’individu et le former en tant que créateur.
Steven Spielberg ne fait donc pas exception à la règle. Reconnaissons-le, hormis l’exception insolite de Ready Player one, depuis une bonne vingtaine d’années, Spielberg se retourne systématiquement vers le passé : il faut remonter à La Guerre des mondes pour dénicher un Spielberg contemporain de son époque, ce que l’on peut expliquer par le traumatisme vécu lors des attentats du 11 septembre 2001, dernier fait historique récent dont Spielberg a témoigné via un remake d’un film de science-fiction. Son dernier film sorti en date, West Side Story, représentait ainsi une tentative de créer une version modernisée d’un spectacle de la fin des années cinquante, mais était trop éloignée de la version originelle pour satisfaire les fans, et trop proche de cette dernière pour plaire à ses détracteurs. Cette tendance nostalgique, Spielberg n’essaie pas d’y échapper, il la cultive même.
C’est pourtant la première fois que Spielberg se livre à l’exercice de l’autobiographie de manière aussi directe. Il avait déjà distillé par endroits de-ci de-là des parcelles de son histoire personnelle, à chaque fois assez dissimulées derrière son art de la narration et du grand spectacle. Rencontres du troisième type, E.T., Empire du soleil, Arrête-moi si tu peux, contiennent ainsi des bribes du passé de Steven Spielberg, déversant leur lot de familles dysfonctionnelles et d’enfants perdus, abandonnés à leur sort, Ce n’est que la troisième fois que Spielberg signe le scénario de son film, après Rencontres du troisième type et A.I. intelligence artificielle. Ce désir de fiction autobiographique le taraudait depuis plus de quarante ans puisque en 1978, il avait déjà confié au tandem Zemeckis-Gale l’écriture d’un scénario revenant sur son enfance. Mais sa légendaire pudeur a sans cesse différé la réalisation de ce projet qui lui tenait pourtant à coeur. Il a fallu un événement crucial, la mort de son père en 2020, trois ans après celle de sa mère, pour qu’il se résolve à aborder peut-être l’histoire la plus douloureuse de sa vie, celle qui se trouve à l’origine de toutes ses histoires de cinéma.
Au commencement était donc le cinéma, plus particulièrement une séance de cinéma qui lui faisait peur, celle de Sous le plus grand chapiteau du monde de Cecil B. de Mille. Accompagné presque de force par ses parents, le jeune Sammy vit alors un traumatisme profond et durable. D’un côté, son père, scientifique, (le placide Paul Dano) le rassure sur la nature inquiétante du phénomène cinématographique, en lui expliquant que le cinéma, ce sont simplement vingt-quatre images par seconde. On croit presque entendre la réplique fameuse du Petit Soldat de Godard, « le cinéma, c’est la vérité vingt-quatre fois par seconde » . De l’autre, sa mère, (merveilleuse Michelle Williams), l’artiste, musicienne et concertiste qui a sacrifié sa carrière pour ses enfants, rassure Sammy, en lui assurant que ce sont des rêves sur pellicule. Là aussi, on croit presque entendre Orson Welles et sa célèbre expression du ruban de rêves.
Il faudra que se joigne au couple le meilleur ami du père (Seth Rogen dans un rôle inattendu de sensibilité) pour que se forme un trio à la manière de Jules et Jim, un Jules et Jim chaste et empêché par la morale et les convenances de l’époque. On comprend aujourd’hui à quel point Spielberg a pu être marqué par le film de Truffaut et y reconnaitre un écho direct de son histoire familiale personnelle. En parallèle, Sammy commence à tourner de petits films amateurs avec ses soeurs ou ses camarades d’école, changeant souvent de distribution en fonction des déménagements fréquents causés par le métier de son père. Il grandira pour s’affirmer enfin cinéaste, d’où la rencontre mythique avec un John Ford, admiration de toujours, campé ici par David Lynch, dans une séquence destinée à devenir culte. The Fabelmans est ainsi un film en apparence léger et drôle qui se révèle progressivement déchirant. Comme l’annonce un des oncles de Sammy, interprété par Judd Hirsch (Des gens comme les autres, A bout de course), « l’art et la famille, ça va te déchirer en deux! » , indiquant à quel point la famille peut empêcher l’art et réciproquement. Le cinéma représente ici une passion dévorante à laquelle beaucoup de choses et de personnes se verront sacrifiées, un instrument de vérité et de combat certes (en particulier contre l’antisémitisme) mais également un ogre dévorant comme Saturne ses propres enfants. D’une certaine manière, Spielberg rejoint la dimension crépusculaire d’un Eastwood dans la dissection d’un mythe originel mais surtout fait pour la première fois de l’un de ses travers habituels, le sentimentalisme, une de ses forces. Dans The Fabelmans, l’émotion ne se cache plus et n’existe pas pour se donner bonne conscience, elle se trouve au coeur du projet,, elle est incontestablement nécessaire, ce qui rend ce film de Spielberg, introspectif et récapitulatif, essentiel pour tous ceux qui aiment le cinéma.
Remy Pignatiello


