Lors de la première partie de cette rencontre, Justine Triet a évoqué avec nous sa formation aux Beaux-Arts, la naissance de sa vocation de cinéaste, les grands metteurs en scène qu’elle admire (Fleischer, Cassavetes, Kieslowski, liste non exhaustive), son changement de méthode de mise en scène, ainsi que The Zone of Interest de son collègue, Jonathan Glazer, pour qui elle nourrit le plus grand respect. Place cette fois à son film, l’exceptionnel et indispensable Anatomie d’une chute, récompensé d’une Palme d’or cette année, qui s’améliore encore à chaque vision, ce qui paraît pourtant impossible. Cette seconde partie permettra à Justine Triet d’expliquer sa fascination pour l’affaire Amanda Knox, de parler de Gone Girl de David Fincher, de l’interprétation de son film par Rebecca Zlotowski, du Garçu de Maurice Pialat, des affaires O.J. Simpson et Grégory, de Jack l’Eventreur, de Don Draper dans Mad Men, de Marriage Story de Noah Baumbach, de Magnolia de Paul Thomas Anderson, de Tendres Passions de James L. Brooks et de Eyes wide shut de Stanley Kubrick.

En présentant votre film, vous avez beaucoup mentionné l’affaire Amanda Knox [étudiante américaine accusée en 2007 d’être impliquée dans le meurtre de sa colocataire, NDLR]. Pourquoi n’avez-vous pas simplement adapté cette affaire au cinéma, en l’arrangeant plus ou moins?
Oh non, cela ne m’aurait pas assez intéressée. Non, parce que ce qui m’intéresse dans l’affaire Amanda Knox, c’est la figure de cette fille très belle. brillante, vraiment intelligente et la manière dont son intelligence est vue comme du machiavélisme. C’est cette figure-là qui m’intéresse, tout le procès ne m’intéresse pas au point de vouloir l’adapter. Ce qui m’intéresse, c’est ce que cette figure incarne. En plus, il y a déjà eu beaucoup de documentaires sur elle. Faire une fiction dessus, je trouve ça assez redondant. Moi j’ai du mal à voir des fictions sur des faits divers, je trouve ça souvent très mauvais. J’adore les faits divers, les histoires. Mais je trouve ça très compliqué de faire une bonne fiction à partir de faits divers. Il n’y a que Fincher qui arrive à adapter des faits divers, quoique c’est plutôt une fiction adaptant un roman inspiré d’un fait divers, je crois…

Gone Girl, oui, Gillian Flynn, la romancière qui a signé l’adaptation de son propre roman, s’est inspirée de la disparition d’Agatha Christie. Dans Anatomie d’une chute, vous avez voulu laisser les spectateurs dans le doute et l’incertitude, en évitant la mécanique américaine du twist final. On rejoint l’idée de laisser toute liberté d’interprétation aux spectateurs comme dans vos premiers courts métrages. On pourrait presque organiser un sondage à la fin des projections « Sandra coupable ou innocente? », en interrogeant les spectateurs et je ne sais vraiment pas quel résultat en sortirait.
Moi non plus car j’ai vu tellement de gens me dire qu’elle est coupable ou innocente donc j’ai eu les deux. Même si le film se présente au début comme un who dunnit, la question de la culpabilité se transforme progressivement. C’est Rebecca Zlotowski [réalisatrice de Belle Epine et des Enfants des autres, NDLR] qui a vu mon film et m’a dit une chose assez intelligente : peut-on être responsable sans être coupable ou bien être coupable sans être responsable? Le personnage de Sandra a pu être responsable du suicide de son mari sans être coupable de l’avoir tué ou elle a pu le tuer sans être responsable de son mal-être. C’est cela que je trouve passionnant, c’est cette question-là qui est plus importante que de savoir si elle l’a tué ou pas.

Le meurtre ou le suicide, c’est un peu un prétexte pour attirer le spectateur dans les rets de l’intrigue. Le point de bascule, c’est la déjà fameuse séquence de dispute, où l’on s’aperçoit que la profondeur du film va beaucoup plus loin qu’une simple histoire de meurtre. En fait, à partir de ce moment-là, on se fiche quasiment de savoir si elle est coupable ou innocente mais on essaie de comprendre ce qui a bien pu arriver à ce couple. Pour moi, contrairement aux apparences, ce n’est pas un film sur la vérité, comme le sont la plupart de vos films, mais un film sur la réalité, celle qui existe ou celle qui est mise en scène au tribunal, ou encore celle qu’on choisit. A mon avis, vous êtes passée à un autre stade où votre interrogation se porte sur la réalité, et non plus sur la vérité. A maintes reprises, dans votre film, des bouts de dialogue font référence à la réalité dès la conversation inaugurale entre Sandra et la journaliste, puis dans les discussions entre Sandra et son avocat, lorsque Sandra déclare « that recording is not reality », ensuite quand le psy de Samuel fait référence à sa réalité, ou quand une journaliste cite ses propos, « mon travail, c’est de brouiller les pistes pour que la fiction détruise le réel », ou encore lorsque, après que Vincent, l’avocat de Sandra a démoli l’image de son mari, elle lui dit « that was not Samuel ».
Oui, c’est vrai. D’ailleurs quand elle dit, « it warps everything », quand elle parle de l’enregistrement, tu prends des moments de grande intensité et tu le captures comme ça, cela déforme tout, c’est nous et ce n’est pas nous, en fait. C’est nous mais ce n’est pas nous totalement. De nous réduire à cela, ce serait une erreur. C’est vraiment ce que vous dites. Et la phrase « but that was not Samuel », c’est vraiment important à ce moment-là. C’est marrant que cette phrase, vous l’ayez retenue car personne ne l’a retenue. Cette phrase, j’y tenais beaucoup et Sandra y tenait aussi. Elle disait « je ne peux pas applaudir la prouesse d’un avocat qui dit, voilà, ce type était suicidaire et se lamentait parce que sa femme réussissait et pas lui » parce que ce n’est pas vrai. Pour gagner, tu dis des conneries, tu racontes n’importe quoi, C’est ce que je trouve tragique et passionnant dans le monde judiciaire, c’est l’endroit de la fiction, où pour la défense d’un camp ou de l’autre, on déforme absolument tout. C’est l’endroit du récit, de la fiction, précisément l’inverse de ce qu’un enfant croit quand il espère que, dans un tribunal, va surgir la vérité. La vérité surgit très rarement dans l’enceinte d’un tribunal, sauf dans des affaires très simples, où le mari a tué sa femme, et où on sait déjà par avance ce qui s’est produit.

Pour l’enfant, Daniel, la réalité, c’est en fait ce qui l’arrange. Ce n’est pas la vérité, ce qui a réellement eu lieu. C’est ce qui lui permet de fonctionner en tant qu’être humain à l’avenir.
Oui, exactement. C’est hyper fort ce que vous dites car personne ne m’a jamais dit ça. C’est hyper intéressant car c’est vraiment ça. Cela me passionne beaucoup plus que de savoir si le gosse sait ou ne sait pas. C’est l’idée qu’il va devoir créer un récit et il choisit le récit avec lequel il va vivre, en gros. Ce n’est pas totalement vrai car quand il l’a choisi, il revient chez lui et tous ses doutes finissent par l’assiéger. L’avant-dernière scène du film est là aussi pour nous montrer ça. J’avais écrit toute une série de dialogues entre la mère et son fils, que j’ai enlevés au montage. Parce que je trouvais le film déjà trop verbeux et que je n’avais pas envie de rajouter une autre conclusion après la scène du restaurant. Mais cette scène, c’est vraiment « comment va-t-on faire maintenant? Tout est redistribué ici. » A la fin de l’écriture, une des scènes qui m’a demandé le plus de travail, c’est celle du restaurant chinois. Cette scène est très compliquée, je voulais qu’elle dure vingt minutes. Il y a eu plein de versions différentes où ils restaient très longtemps au restaurant et rentraient après. J’étais obsédée par Le Garçu de Pialat. Je me souvenais de cette fin au restaurant, une scène très complexe de rupture, de tristesse et de joie, où tout se mélangeait, un mélange que je trouvais très fort. J’ai vu beaucoup de films de procès, de documentaires de procès et une chose que je voyais rarement, c’est finalement après le verdict, qu’est-ce qui se passe? J’étais assez intéressée pour me renseigner sur plein d’affaires, l’affaire O.J. Simpson, la fête après sa libération. le restaurant qu’ils ont créé après le verdict de l’affaire Grégory. C’est un moment qui m’a toujours fascinée comme spectatrice, ce qui se produit après le verdict. Souvent, cela m’intéresse plus quand le verdict est joyeux, positif, quand la personne est libérée, car je me demande comment elle gère l’après, de façon très concrète. Souvent, il y a donc cette chose à célébrer, avec un fond de tristesse à côté. Je me suis dit, il y aura cet endroit où il faudra célébrer, manger, etc. et puis il faudra rentrer. Et donc l’idée que ce personnage de Sandra aura peur de rentrer car elle sait précisément que son fils a soit inventé ce récit soit…En tout cas l’idée qu’il va falloir que la réalité dont vous parlez va vraiment se concrétiser dans ce retour à la maison, où tout va finir par ressurgir. Cela m’a hantée pendant toute l’écriture. Jusqu’à la fin, je me disais que le film sera nul si je ne trouve pas la bonne fin. Il faut trouver la bonne fin. C’était très dur car j’en ai discuté avec Le Pacte. Je voulais une fin beaucoup plus longue. Pour cette scène de restaurant, il y avait une version que j’adorais, un très long moment d’alcool, après ça se calmait et on rentrait. Mais c’est vrai que c’était hyper-long. Mais j’aimerais bien mettre la scène dans les bonus de l’édition vidéo car cela m’a trop énervée de ne pas l’avoir mise. Il existe deux scènes dont je suis malade de les avoir enlevées. Ce n’est pas pour rien, c’est pour dire attention spectateurs, si vous imaginez que mon intention est de clore ce film au moment du procès, détrompez-vous, ce n’est vraiment pas ça qui m’intéresse. Ce qui m’intéresse, moi, c’est le retour, c’est comment on rentre. Cela me passionne dans plein d’affaires.
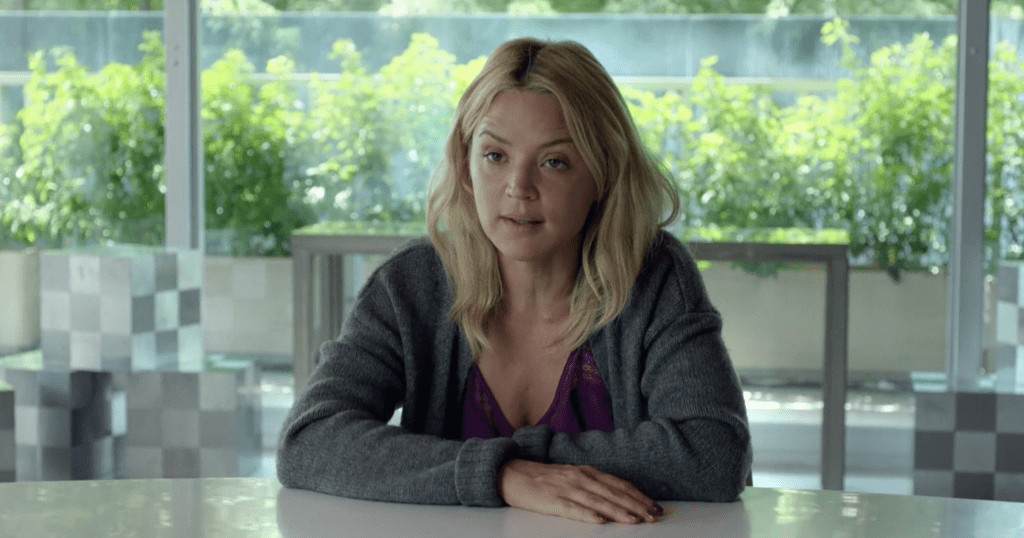
Vous êtes évidemment féministe, mais pas d’un féminisme naïf mais d’un féminisme qui peut défendre des femmes qui ne seraient pas complètement irréprochables (elle rit). On a mentionné plus haut la haine qui peut se déclencher contre les femmes cérébrales, trop brillantes, en maîtrise d’elles-mêmes, comme dans Gone Girl de David Fincher, ou encore Basic Instinct de Paul Verhoeven, voire, pour un exemple de procès récent, contre Amber Heard qui n’est pas forcément irréprochable. J’ai retrouvé un dialogue de Victoria, votre deuxième film, où vous faites dire à Virginie Efira, « être misogyne, c’est de penser que les femmes sont des victimes par nature ».
Oui, je me souviens de cette phrase. C’est une phrase (elle rit)…je ne sais pas si j’aurais le cran de la remettre à nouveau dans un film. C’était assez naïf de ma part de dire ça et en même temps, j’assume encore une part de cette phrase. Mais c’était assez naïf. Parce qu’en réalité, malheureusement et socialement, ce n’est pas pareil pour moi de parler en tant que personne appartenant à une certaine classe. C’est plus facile pour moi de dire ça. Quand je le dis, c’est dans le sens très précis de dire : attention, je ne veux surtout pas enfermer le féminisme dans le fait de défendre des victimes, en disant, regardez ces pauvres femmes qui souffrent. Pour moi, c’est encore différent car il y a trois questions en une dans ce que vous me dites. Attention, quand j’écris un scénario, je ne pense pas féminisme. Je pense écrire quelque chose qui me tient à coeur. Je ne me dis pas oh lala, je vais ériger un modèle. Je suis profondément féministe. Dans ma vie quotidienne, je le suis, mes amis le voient bien. Je n’ai pas attendu #MeToo pour l’être. Je fais une petite digression : une fois, dans une salle de cinéma, quelqu’un m’a dit « mais enfin, vous faites un film, vous montrez une femme qui a peut-être tué son mari, vous vous rendez compte de tous les féminicides que les femmes vivent, c’est quand même un scandale ». Je lui ai répondu ce que je pense vraiment : « je n’ai pas envie, moi, d’ajouter une figure de plus de femme martyre, martyrisée, violée, torturée ». Récemment j’ai revu un film que j’adore, un peu nul, Jack L’Eventreur, des années 80. C’est fou, je voyais ces gens fascinés par ces femmes dépecées dans tous les sens, je me suis dit que la fascination de cette destruction de la femme vient du fait qu’on ne la comprend pas, et qu’on a presque besoin de la mettre en mille morceaux pour comprendre ce qui se trouve à l’intérieur. Moi j’ai l’impression que rajouter un récit de plus de femmes séquestrées ou tuées, je n’en vois pas l’intérêt. L’histoire de la littérature et du cinéma est remplie de ça. J’adore James Ellroy mais je n’ai pas besoin de rajouter un récit supplémentaire sur ça. Indépendamment de cela, pour répondre à une autre question, quand j’écris un film, je refuse, et pour moi c’est presque politique, de faire de la femme un modèle. Cela m’angoisse, cette idée-là. Je refuse de faire des films à thèse ou édifiants. C’est l’angoisse absolue. Pour moi, mon personnage, je l’aime, je le défends, mais je l’aime comme j’adore Don Draper dans Mad Men, qui serait comme Le Parrain ou Les Soprano de notre époque, une série où l’on voit un type qui a tué, qui est à la fois plutôt sympathique et très antipathique aussi, mais qu’on adore. Je prends cet exemple-là pour dire que c’est très long, l’acceptation de montrer aussi un personnage féminin, qu’on aimerait avec énormément de défauts, je ne parle pas de petits défauts gentillets, mais de vrais endroits d’impureté. Je trouve ça plus intéressant, même moralement, quand des personnages se trouvent sur le fil. Je déteste l’angélisme autour des personnages, C’est une chose qui me dégoûte presque.

Dans Anatomie d’une chute, il existe une réflexion sur le partage des rôles dans un couple. Quand Samuel se plaint parce que la plupart des tâches domestiques ou d’éducation de l’enfant lui sont revenues, cela crée un flash chez les spectateurs hommes qui comprennent alors, au cas où ils ne l’auraient pas déjà compris, la charge qui a pesé sur les femmes de travail domestique et d’éducation des enfants et qui les a empêchées ou gênées depuis des décennies voire des siècles de mener une carrière ou un travail artistique. C’est intéressant, cette inversion des places qui fait que, justement, les hommes, en regardant ce film, vont comprendre davantage la situation des femmes.
Quand on disait tout à l’heure, que je n’écrivais pas en pensant féminisme et que je trouverais ça dangereux pour le récit, en revanche, cette scène, elle a été effectivement pensée comme ça et je me suis amusée à inverser les codes. Il y a une histoire de films de procès, une histoire de films de genre, une histoire de scènes de dispute. Un an ou deux avant, j’avais vu Marriage story de Noah Baumbach où figure cette fameuse dispute entre Adam Driver et Scarlett Johansson. Je me souviens m’être dit « mais elle doit répondre ça, pourquoi elle ne répond pas ça, etc ». Pourquoi l’homme, je le trouvais passionnant tandis que la femme, c’était comme si elle n’avait pas droit à la parole, pourquoi elle répondait ça alors qu’elle aurait dû répondre ça. Cette scène dans mon film est conçue au regard de plein d’autres scènes de dispute, par exemple chez Bergman. C’est impossible d’écrire une scène de dispute sans penser à d’autres scènes de dispute. Il y en a eu tellement dans l’histoire du cinéma. La différence peut-être ici, en tout cas, c’est ce que j’ai essayé de faire, moi, et qui m’a obsédée. C’est une scène qui a été écrite 55 ou 60 fois et on n’était jamais d’accord. A chaque fois je la lisais et je disais à Arthur [Harari, compagnon et coscénariste de Justine Triet, réalisateur de Diamant noir et Onoda, NDLR], ils ne sont pas intéressants, ces gens, ils nous ennuient, ces gens, on ne les aime pas. On se renvoyait les versions, on se disait qu’on craignait que les spectateurs se disent qu’ils n’en aient rien à foutre de ces gens. On se disait : mais qui ça va intéresser, la vie de ces gens? C’est la scène qu’on s’est le plus renvoyée. Je lui ai dit « écoute, laisse-moi l’écrire car là, ça me rend folle ». Il en avait écrit une grosse partie. J’ai repris une grosse partie et j’ai senti que j’ai trouvé le truc. Et là, il l’a repris et on a vraiment trouvé qu’il y avait quelque chose. En fait, mon film est sur le langage, le langage de pulsion ou le langage organisé du tribunal. L’écueil des scènes de dispute, c’est que la pulsion règne, il n’y a plus rien, que des insultes. Pour moi c’était impossible car c’est un couple d’intellos, elle, elle maîtrise leur espace, Il fallait qu’il y ait une beauté, une classe. Ils s’engueulent mais ce doit donner un truc beau. Donc j’ai essayé de repousser la pulsion, en sachant très bien qu’à la fin, elle allait finir par arriver. C’est le thème du film, la mort et on se demande si elle ne l’a pas tué. A la fin on entend cette dispute qui devient très violente et on ne sait pas qui frappe qui. L’idée était de faire une scène qui serait un combat théorique où la pulsion, on la repousse, on la repousse, on la repousse…Dès qu’il part dans la pulsion, elle proteste et dit « on s’aime, tout va bien, regarde, on peut faire ça, etc.. ». On se trouve dans une espèce de composition théorique jusqu’à l’endroit où il n’y a plus de possibilité d’aller. Je trouvais ça intéressant en fait de déconstruire le cliché des films français pour les étrangers : soit Rohmer qui est vraiment l’inverse, soit les engueulades avec la casserole, le côté Pialat qui peut être magnifique. Nous, on s’est dit qu’il fallait arriver à sortir de cette alternative, en apportant du discours.

Vous avez raconté dans un bonus du DVD de Victoria lors de sa présentation en avant-première à l’UGC Ciné-Cité les Halles, que, pour payer vos études, vous étiez ouvreuse dans ce cinéma quelques années auparavant et que vous avez vu plus d’une cinquantaine de fois la fin de Eyes wide shut de Stanley Kubrick. Je me suis demandé si ce n’est pas de là que vient votre obsession du couple! (elle rit).
Ah, Eyes wide shut, un de mes films de référence, je l’ai vu tant de fois. C’est vraiment rigolo que vous disiez cela. Il y a deux films contemporains de ma jeunesse qui ont fondé ma cinéphilie. Evidemment il y a plein de films des années 60-70 que j’ai vus, mais ils n’étaient pas contemporains. J’en ai presque honte pour l’un des deux car c’est un film que je ne peux pas revoir, tellement je ne l’aime plus, c’est Magnolia [Paul Thomas Anderson, 1999] que j’avais adoré quand il est sorti mais j’aime beaucoup moins le film maintenant. J’ai presque honte mais je me souviens qu’en le voyant, je me disais « je rêve de faire des films! » Et je me souviens de Eyes wide shut. C’était très différent, un film que je n’avais pas forcément totalement compris à ce moment-là. Quand je l’ai revu, j’ai compris bien plus tard de quoi il s’agissait. Mais il m’a fascinée de manière beaucoup plus naïve. J’avais 20-21 ans quand je l’ai vu en 1999. A l’époque, l’UGC Ciné-Cité les Halles ouvre, tout le monde a son petit costume bleu, moi j’ai besoin d’argent. Je postule, c’est un costume atroce, j’ai honte (rires). La même année, j’ai postulé au Forum des Images et j’ai été prise aux deux. J’ai choisi l’UGC Ciné-Cité les Halles. J’ai fait beaucoup de petits boulots jusqu’à très tard. C’est donc là que j’ai vu Eyes wide shut. J’ai fantasmé sur ce film pour des raisons débiles de groupie car j’étais complètement fan de Kidman et de Cruise. Je n’avais pas compris à l’époque toute l’ironie de Kubrick de faire jouer ce couple. Je n’avais pas compris ce que j’ai compris plus tard, tout ce dont parle vraiment le film. Mais cela fait partie des souvenirs les plus forts que j’ai eus. Vous savez comment ça se passe, ils vous disent d’aller faire les poubelles, d’enlever tout ce qui se trouve dans la salle et il faut donc venir un peu avant la fin. Et moi je venais de plus en plus tôt, pour voir de plus en plus du film. Je n’avais rien, j’avais le moment du magasin de Noël qui n’est pas le moment le plus dingue du film. Mais je me souviens très bien m’être dit, ça a l’air dingue, ce film, qu’est-ce qu’on peut voir maintenant? « Fuck! » La plupart du temps, je ne voyais que deux choses de ce film, le générique avec la grande valse de Chostakovitch et « Fuck! ». Cela a l’air fou, ce film, il ose tellement, Kubrick! C’était vraiment très naïf. Evidemment, après, j’ai vu le film en entier. J’avais au moins ce droit-là à l’époque, quand je bossais là-bas. J’ai été très impressionnée, sans en comprendre tout. Je l’ai revu et revu. A l’époque, j’étais assez gênée par Nicole Kidman. Je me disais qu’elle surjouait lors de la scène du pétard, etc. J’étais fascinée par l’image du film, très impressionnante et c’est probablement le film que j’ai le plus revu après, vu, revu et revu, etc. Et puis j’ai appris tout le délire du tournage. Moi je n’avais pas du tout compris le délire de Kubrick de recréer toute cette ville. L’histoire m’a fascinée. C’est évidemment le film ultime sur le couple. Vous me parliez tout à l’heure de la réalité de ce qui est réel ou pas. C’est un film que j’ai beaucoup vu avant Sibyl, même si évidemment Sibyl n’a absolument rien à voir avec ce chef-d’oeuvre, mais c’est un film qui m’a beaucoup hantée. Sur la représentation, je ne trouvais pas géniale la représentation des scènes entre Kidman et le marin, un peu cheap. Je me disais que si Kubrick avait été vivant, il n’aurait jamais laissé ça au montage. En revanche, j’ai été, comme plein de gens, éblouie par le film. A l’époque je n’étais pas entourée que de cinéphiles et je connaissais plein de gens qui étaient très agacés par le film. C’est très étonnant. Cela fait partie des films qui sont devenus des chefs-d’oeuvre incontournables, avec le temps. Comme certains films qui sont repensés comme Tendres Passions [James L. Brooks, 1982, NDLR] qui a été détesté à sa sortie par Daney puis repêché par je ne sais pas qui. C’est un peu différent pour Kubrick mais je me souviens qu’il n’était pas aussi évident à sa sortie, qu’il était assez clivant.
Dans Sibyl, il existe d’ailleurs des moments musicaux où l’on croirait entendre la partition de Eyes wide shut.
Oui, tout à fait, c’est un hommage. La musique a été aussi inspirée par la bande-son de Bo Harwood pour l’un des films de Cassavetes, Une Femme sous influence ou Opening night. Il manie aussi des notes similaires.

Au sujet de Eyes wide shut, je ne vais pas vous poser la question de l’inspiration autobiographique qui, à mon sens, n’a pas grand intérêt. Mais avez-vous pensé que cela pouvait mettre en danger votre couple de co-écrire cette histoire en raison de ce matériau très inflammable, que vous acceptiez d’en prendre le risque, et que cela pouvait en valoir le coût, pour atteindre une qualité artistique très élevée? (elle rit totalement). Le syndrome Eyes wide shut, en fait (elle rit de plus belle).
Hahaha! En toute honnêteté, Arthur et moi, nous ne sommes pas des icônes du tout! J’adorerais mais nous en sommes loin. En toute honnêteté, je vous jure que c’est vrai. Comme mes amis le disent souvent, c’est même un problème dans ma vie, je fais souvent les choses de manière innocente sans comprendre, sans analyser. Sans mentir. vraiment je n’avais pas imaginé qu’on allait travailler autant en couple avec Arthur. Je lui ai demandé un coup de main pour deux ou trois mois, je ne pensais pas qu’on allait travailler autant. On n’a pas du tout conscientisé ça, on l’a conscientisé ça extrêmement tard et c’était déjà beaucoup trop tard pour remettre cela en question. Je pense qu’honnêtement j’ai eu peur que le côté sombre du film – pas forcément l’aspect du couple- ne nous dévore. Ce côté sombre me faisait peur surtout au début de l’écriture : je faisais des cauchemars tout le temps, je n’arrêtais pas de dire que ce film me faisait peur car il était trop violent par ses sentiments. Je l’ai beaucoup formulé à Arthur : « je ne sais pas si c’est une bonne idée d’écrire ce film, il faut que je fasse une comédie » (rires). J’étais complètement terrorisée. A chaque fois, l’un ou l’autre, on se relançait en disant « mais non, il y a un truc sur ce film ». Vous savez, on parle des films qui sortent mais il y en a plein qui ne sortent pas. J’ai écrit deux projets avant ce film-là que j’ai laissés en friche, alors que j’en avais écrit un énorme paquet. Certains films, ils sont rejetés parce que j’en ai peur ou parce que je ne les trouve pas assez bons. Celui-là, à un moment donné, on l’a rejeté pendant très longtemps. J’ai donc eu peur à un moment donné. J’écris des histoires en fait pour ne pas les vivre. J’ai toujours eu cette impression, même pour Sibyl. Je transpose mes angoisses, mes pires cauchemars dans mes films. C’est l’inverse presque, je le fais pour ne pas les vivre, pour les exorciser.

Si cela peut vous rassurer, Sibyl, je l’ai revu récemment et je trouve qu’il gagne vraiment à être revu. On sent malheureusement qu’il manque des choses.
Merci, c’est gentil. Oui c’est parce que le film a été tronqué d’une heure.
Vous n’avez pas de possibilités de la récupérer, pour en faire une version director’s cut? (rires).
C’est compliqué. Je vois ce que vous me dites, il y a des endroits où c’est ample et d’autres où l’on se demande ce qui s’est passé.
Oui, le montage paraît parfois un peu abrupt. C’est dommage car, par rapport à Victoria et Anatomie d’une chute, Sibyl apparaît comme un film de transition alors que ce film très personnel aurait pu devenir une oeuvre plus considérable. D’ailleurs, toute dernière question, vous avez fait une trilogie politique (Sur place, Solférino, La Bataille de Solférino) puis une trilogie de portraits de femmes (Victoria, Sibyl, Anatomie d’une chute), allez-vous commencer une nouvelle trilogie? (elle rit).
Je ne sais pas! J’ai deux projets en tête, un très très cher et un très cher. J’adorerai vous répondre mais je n’ai pas encore eu le temps de me retourner, Je suis un peu perdue pour la suite. En tout cas, je vais réfléchir pour le concept de trilogie! Je trouve ça intéressant. Merci beaucoup de m’avoir posé des questions que personne n’a pensé à me poser.
Entretien réalisé par David Speranski à Paris.
Retrouvez la première partie de cet entretien exceptionnel avec Justine Triet où elle évoque sa formation aux Beaux-Arts, la naissance de sa vocation de cinéaste, les grands metteurs en scène qu’elle admire (Fleischer, Cassavetes, Kieslowski, etc.), son changement de méthode de mise en scène, ainsi que The Zone of Interest de Jonathan Glazer.



